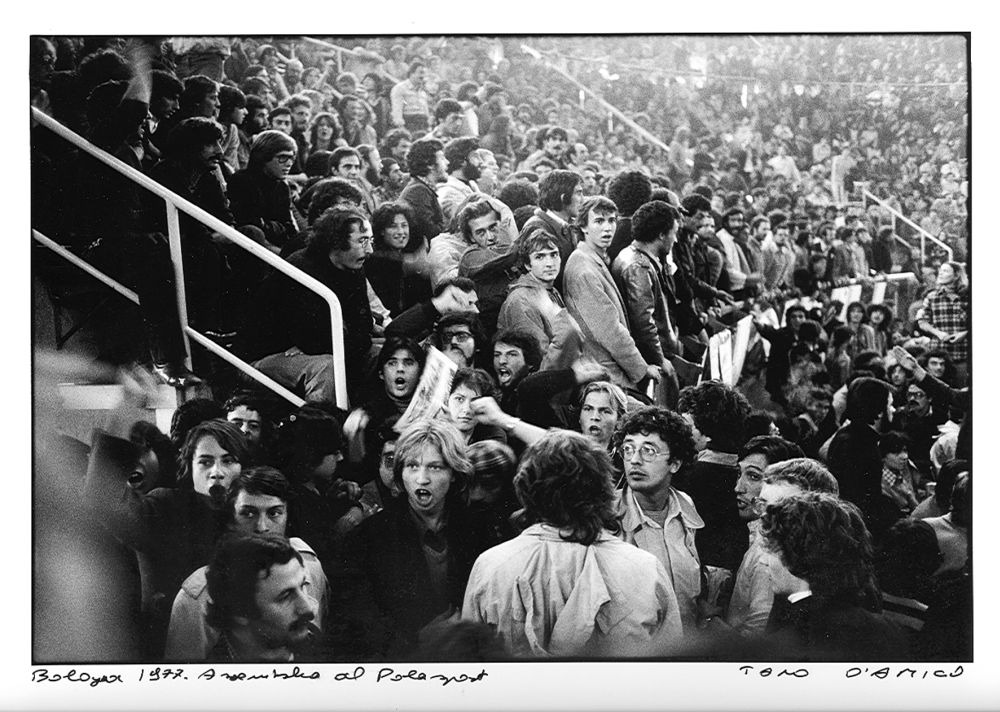
Ce texte d’Oreste Scalzone, traduit pour la première fois en français, a été écrit en novembre 1978 pour le complément au numéro 0 de la revue Metropoli. Cette revue avait pour ambition de constituer une « aire de débat » au sein de l’autonomie, susceptible de créer les conditions d’une recomposition politique la plus large possible, dans un contexte de morcellement organisationnel consécutif au mouvement de 1977, d’impasse stratégique et d’offensive croissante des formations armées. Essayant de saisir, dans toutes ses implications, le changement d’époque qui était en train de se produire, mêlant intervention militante et approfondissement théorique, avec des collaborateurs tels que Franco Piperno, Paolo Virno, Lucio Castellano et d’autres, Metropoli peut être considérée comme l’une des expériences les plus intéressantes de la dernière phase de la séquence autonome italienne.
Aujourd’hui, il est clair que ni les enjeux ni les termes de la discussion ne sont les mêmes. Scalzone développe en particulier une critique sans concession des groupes organisés existants et s’attaque à « l’unidimensionnalité » des formations combattantes qui réduisent le spectre de l’action politique au seul niveau militaire – singularisant par là même l’hypothèse autonome (en écho d’ailleurs à ce qu’explique Donato Tagliapietra dans son interview pour ACTA à propos des Collectifs Politiques Vénètes).
Mais si nous avons traduit ce texte c’est qu’il nous semble aussi contenir de puissantes intuitions pour le présent. Sa problématique fondamentale, qui pour nous demeure, consiste à penser les conditions d’un dépassement du paradigme léniniste traditionnel (qui a déterminé l’essentiel de la politique révolutionnaire au XXème siècle). Explicitant tout d’abord la « crise du concept classique de l’avant-garde », Scalzone en vient à proposer les linéaments d’une théorie de l’organisation « après le déluge ». La caractéristique principale de cet hypothétique « sujet de parti » est de se concevoir comme unité et synthèse de fonctions multiples, d’être une forme d’organisation multi-dimensionnelle, qui sache apprécier la « puissance possible d’un usage combiné de tactiques et de formes de lutte diverses ».
Des formules qui ne peuvent que faire écho aux efforts de celles et ceux qui, depuis plusieurs mois, tentent de consolider des alliances entre différents segments militants et foyers de contestation, qui oeuvrent à l’expérimentation de formes d’organisation transversales pouvant articuler de multiples secteurs d’intervention afin de répondre aux défis de la période en cours.
[L’article de Scalzone inclut des passages de « commentaire » du texte principal, que nous avons figurés par des traits séparateurs.]
Si l’on envisage la rupture révolutionnaire comme passage au sein duquel se détermine une synergie décisive de forces de transformation pour ratifier les contenus émancipateurs qui se sont développés de manière moléculaire – à travers l’autonomie et le contre-pouvoir – « dans le ventre de la vieille société » ; si on l’interprète comme point critique, comme passage, ligne de crête entre processus émancipateur et processus de libération ; si on l’envisage comme « rupture initiale » (limitée mais décisive) dont procède une chaîne d’événements révolutionnaires, nous devons avancer quelques hypothèses sur le long processus de « guerre de libération » qui constituera le parcours de l’extinction.
C’est tout un discours à faire. Mais en attendant, ce discours a des conséquences sur le terrain de la théorie de l’organisation.
Si – comme nous le disons depuis longtemps – la composition de classe s’est transformée (au sens où le mouvement général est plein d’« éléments de communisme »), il s’en suit que toute une série de fonctions, de prérogatives, de capacités qui par le passé se trouvaient hypostasiées dans le sujet séparé de parti, se présentent aujourd’hui comme organiques à ce sujet de masse. C’est-à-dire vivent en son sein, dans ses formes d’expression, d’action, de lutte, de connaissance, de socialité ; dans son « sens commun », dans sa pratique transversale.
Bien sûr, le fait que nous parlions de mouvement du communisme à l’état naissant ne veut pas dire que la grande majorité des prolétaires ait « choisi Le Capital comme livre de chevet » ; cela veut dire que les besoins, désirs, comportements, modes de raisonnement, luttes, expectatives, pratiques quotidiennes d’entières sections de la classe sont toujours plus irréductibles à la nécessité de reproduction de la forme sociale capitaliste.
C’est précisément de cette épaisseur, de cette réunification précédemment inconnue, de cette dense continuité entre immédiateté et prospective, entre dimension quotidienne et projection ; de cette réduction progressive de la distance entre le politique et le social, que naît la crise d’un concept classique, traditionnel, de l’avant-garde. Un concept, pour ainsi dire, « tous azimuts ». Ce qui est fini est le concept d’avant-garde totale, stratégique ; détentrice / portatrice de « conscience » ; consciente (en exclusivité) du sens général, stratégique, des mouvements de lutte, du savoir théorico-pratique nécessaire pour orienter le mouvement vers le dépassement de la forme sociale capitaliste.
À ces observations se rattache la nécessité de se libérer de l’appareil terminologique qui se trouve actuellement utilisé à l’intérieur des fractions révolutionnaires. L’exemple de l’usage « effroyable » des termes « stratégique », « stratégie », vaut pour tous.
Contre cette tradition, nous proposons une redéfinition des signifiants. Nous pourrions, par exemple, appeler :
– stratégie générale de la classe, le communisme comme mouvement réel, donc le devenir matériel de la tendance communiste.
– stratégie spécifique, le mouvement général de l’auto-valorisation1, la riche dialectique entre formes d’organisation et mouvements émancipateurs, tout au long de la période historique qui va de la forme liminaire de l’autonomie – le contre-pouvoir – au début du processus de libération. Appeler donc stratégie le rapport général entre parti de la rupture (et de la synthèse programmatique déterminée qui préside à celle-ci) et mouvement de l’extinction, comme capacité des formes d’auto-organisation de la classe à « réabsorber » la fonction-Parti.
– grande tactique, la science de la rupture (située entre une explicitation de la médiation programmatique capable de promouvoir la constitution politique du sujet social révolutionnaire, et les opérations de désarticulation et d’interdiction matérielle des formes du commandement).
– petite tactique, le « savoir particulier » des mouvements singuliers, et la praxis mise en oeuvre par les formes transitoires d’organisation qui y sont liées.
Si le « mouvement pluri-subjectif » se présente toujours plus comme « conscient de ses propres résultats » ; si le dualisme entre lutte économique et lutte politique tend à se résoudre dans la densité inconnue d’une lutte subversive globale moderne, l’effet qui s’en suit est une remise en crise (ou à tout le moins une drastique réduction) du concept d’avant-garde externe, séparée. C’est cela qu’on entend lorsque qu’on parle de crise de la forme-Parti : le caractère nécessaire, fondé, de « l’écart » jacobin-bolchévique se réduit toujours plus : le mouvement général tend à se poser comme « sujet léniniste de masse » moderne.
Quelqu’un a parlé, à propos de ces transformations, de « léninisme diffus ». Certes, le concept de parti d’avant-garde comme « intellectuel collectif », comme prince moderne, donc comme plus haute autorité ordinatrice et régulatrice des processus de transformation sociale, a échoué. Aujourd’hui le « prince moderne » réapparaît uniquement dans la misère d’une volonté de gérer la « révolution par en haut » dont le capital a besoin ; il réapparaît dans le « péché d’orgueil » de l’autonomie du politique, qui paye ce péché en se condamnant à la perte de tout contenu de transformation radicale significatif. Là, dans cette hypothèse, un « jacobinisme sans révolution », injustifié et arbitraire, se représente comme utopie téléologique, dont le seul contenu réel est une volonté de puissance heureusement frustrée par l’indisponibilité d’un nombre croissant de prolétaires à se laisser « normaliser », à se conformer aux modèles de la discipline de l’État du travail.
Mais sur le terrain révolutionnaire, une fonction de Parti-démiurge n’existe plus. En premier lieu le caractère complexe, non reconductible à l’unité, du savoir social ; en second lieu, l’ampleur et la complexité des processus d’émancipation, leur irréductibilité à un principe téléologique externe, le nombre objectivement grand des variables et la nécessaire ampleur du « laboratoire social », déterminent la fin du Parti-démiurge. L’instrument-parti à l’époque de la révolution communiste se recalibre par rapport à une conception radicalement autre de la « totalité » : alors que l’instrument-parti de l’époque du socialisme est naturellement chargé des tâches de construction, autour de lui, de toute la dynamique de la vie sociale, et donc de sa rationalité (comme conséquence de la centralité de la loi de la valeur – « à chacun selon son travail »), la totalité dont nous parlons à ce degré de maturité des forces productives – c’est-à-dire de l’individu social prolétaire – n’est en aucun cas homologable à la vieille totalité. Celle-ci n’a plus aucun centre, à partir duquel ses processus pourraient recevoir un sens éventuel. Il s’agit en somme de concevoir pleinement un communisme non comme tendance vers un horizon-cadre, vers une redéfinition de la transformation économico-sociale à laquelle devraient être reconduits les mouvements des sujets ; mais comme un « noeud interne » que le mouvement des sujets redéfinit continuellement.
Le mouvement peut commencer aujourd’hui à entendre pleinement comme actuelle l’affirmation de Marx selon laquelle le « passage au communisme » se présente comme passage de la préhistoire à l’histoire de l’humanité, et donc requiert d’être affronté avec un arsenal théorique nouveau, à quoi servent bien peu les catégories antérieures d’une logique pertinente au mouvement de la valeur d’échange.
Si ces observations sont vraies, cela veut dire que l’on a rejoint la crête, la « zone de frontière » au-delà de laquelle commence la fin de la politique, soit la destruction de la séparation et le passage à la pratique communiste intégrale ; en-deçà de laquelle se prolongent les ultimes formes nécessaires de la politique (dans sa forme liminaire de politique révolutionnaire).
C’est justement autour de la distinction entre nécessité résiduelle de formes d’action politique, et caractère résiduel des formes existantes, que s’identifie le facteur discriminant de valeur.
Il a été dit que la critique des organisations est l’unique possible « théorie de l’organisation » adéquate à la maturité du thème de l’extinction – et donc adéquate aux éléments matures de communisme qui vivent dans le mouvement. Cela n’est vrai que partiellement. Et cependant cette « vérité tendancielle » se présente comme déjà réalisée par intermittences.
C’est justement autour de la distinction entre nécessité résiduelle de formes d’action politique, et caractère résiduel des formes existantes, que s’identifie – en effet – le facteur discriminant de valeur.
Étant données les considérations exposées ci-dessus, tendant à relever et souligner le fait que l’enrichissement irréversible du sujet de la transformation a déterminé une tendance, sur la base de laquelle le système possible des relations mouvement/parti se déplace vers une extinction de la fonction-Parti, vers sa réabsorption dans le mouvement, on peut dire que le système actuel de relations réalise déjà un primat stratégique du mouvement général sur les formes séparées de subjectivité organisée.
À l’intérieur de cette tendance se réalisent cependant des phases contrastées, profondément différentes entre elles.
Il y a des phases où les formes d’organisation communiste existantes (quel que soit leur degré de perfectionnement et d’évolution) jouent un rôle résiduel qui rentre dans les fonctions traditionnellement définies comme d’avant-garde (elles assurent la permanence du mouvement dans les « phases basses » de la spontanéité, assument des tâches effectives de suppléance et/ou d’accélération des processus généraux de lutte, développent une tactique indépendante dédiée à la levée des obstacles qui se heurtent au développement du processus d’émancipation).
Dans d’autres phases, les organisations formelles se présentent comme formes résiduelles (le plus souvent sédimentées par un cycle de luttes précédent, puis devenues obsolètes), qui ont un rapport absolument parasitaire aux luttes en cours. Au cours de ces phases, leur présence dans le vif des dynamiques sociales ne remplit aucune tâche positive ; elle ne leur sert qu’à elles-mêmes, pour reconquérir un semblant de légitimation. Dans ce cas, elles finissent par être – par rapport au mouvement – comme des poux vis-à-vis d’une baleine : dans le meilleur des cas elles sont inutiles, dans le pire des cas elles peuvent devenir un danger pour le développement de sa pratique émancipatrice.
LA FORME-PARTI A-T-ELLE ENCORE UN CARACTÈRE NÉCESSAIRE ?
Les questions d’intérêt général que la réflexion, à ce stade, place en tête sont :
a) en tenant compte d’une série de conditions, la forme-Parti sert-elle encore – et à quoi ?
b) si oui, comment (re)commencer à la construire – ou mieux : comment commencer à en construire les pré-conditions ?
À la première question, nous répondons qu’un sujet de Parti est encore nécessaire pour le développement d’un processus d’émancipation et pour son passage, son « saut » vers le terrain de la libération. Nous parlons, naturellement, d’un « sujet de Parti » redimensionné et profondément transformé par l’effet de cette critique pratique de la politique que le mouvement réel conduit (et qui est avant tout érosion et réduction continue de la nécessité résiduelle des formes politiques par rapport aux fins du processus de libération) ; car cela seul détermine le dépérissement tendanciel de la pratique politique spécifique, et autorise des procédures récurrentes de suppression de ses formes d’existence, qui se révèlent progressivement résiduelles.
Il convient de préciser : pourquoi affirmons-nous qu’un sujet de parti possible a encore un caractère nécessaire en vue de la libération du « sujet général exploité » ? Nous disons tout de suite qu’une discrimination entre objectivisme déterministe et subjectivisme volontariste est inutilement « catégorielle » ; le fait est que la solution communiste est « hautement probable » dans la tendance, mais non inévitable, naturelle, automatique. Nous évoluons entre ces deux termes du problème, entre leur possible dialectique interne. Il est clair que cependant, la révolution n’est certes pas inévitable « en l’espace d’une génération ».
Et puisqu’ « à long terme nous serons tous morts », et que donc le millénarisme – à juste titre – ne fonctionne plus, le problème a du sens s’il se pose dans une dimension temporelle proportionnelle à cette « unité de mesure » humaine qu’est la vie d’une génération. Car pour celle-ci la libération est ou n’est pas : son futur, ses « chances » se consument au cours de son unique possibilité d’existence. Chaque génération n’a, en réalité, pas « d’autre opportunité dans l’histoire ».
Venons-en à l’autre point. À quoi sert, donc, la politique révolutionnaire et la redéfinition conséquente d’un sujet de Parti ? Quels problèmes d’ordre général – que le mouvement ne saurait résoudre autrement – la forme-Parti est-elle en mesure d’affronter ? Voyons :
– L’existence du « pouvoir d’interdiction » de l’État fait obstacle à la réalisation, à la consolidation des conquêtes émancipatrices, des dynamiques de libération communiste présentes dans le « mouvement de la valeur d’usage ». Le mouvement reflue, s’arrête ou recule quand il se heurte à la puissance « automatique » de l’État. Il sait en destituer et même en saboter les mécanismes de fonctionnement ; mais il ne sait pas en bloquer la reproduction des fonctions. Il ne sait pas le détruire de manière stable et irréversible. Il ne sait pas ôter à la domination capitaliste son « espérance », sa possibilité de futur. Il y a, donc, une question militaire.
La forme-Parti se présente justement comme spécifiquement dédiée à la désarticulation (à travers une pratique de sabotage/interdiction/destruction de ses éléments constitutifs) du macro-savoir / macro-pouvoir dominant, et à la réalisation, à la traduction en norme d’une série d’éléments émancipateurs, à leur généralisation à tout le corps social.
L’antagonisme envers l’État, le « pouvoir d’interdiction » à son encontre, le sabotage de ses mécanismes de fonctionnement (et, en dernière instance, sa désarticulation et sa destruction) sont des passages qui rendent possible le dépassement du diaphragme entre phase de l’accumulation d’éléments émancipateurs et phase de la libération effective.
– Le mouvement porte en soi une articulation de l’État – dans sa forme et son caractère moderne d’État social. L’organisation, en fait, de la face subalterne (de la force de travail) de la classe, au fondement de son long processus de mutation (un processus de subsomption progressive implacable dans le mécanisme société civile / État) acquiert cette nature, ce caractère d’articulation de l’État pour la subsomption réelle de la force de travail dans le capital. Il y a donc un problème de lutte politique.
Lutte politique contre un « bloc » qui se présente comme idéologie du travail, de la solidarité démocratique, de la discipline sociale, des règles de la démocratie et de la légalité.
– Le mouvement est une tendance d’ensemble, grande et variée, à l’intérieur de laquelle existent des courants divers et même contradictoires ; des « révolutions émancipatrices » souvent antagonistes, qui risquent de se paralyser mutuellement. Il y a donc un problème de synthèse programmatique déterminée.
En ce sens, on peut l’appeler programme de la révolution politique, ce qui veut dire : programme minimal de la rupture initiale, programme « grand-tactique » de la dictature prolétarienne (vue non comme un « status quo », mais comme forme de la « guerre de libération pour le communisme », comme une « synthèse déterminée » de l’univers des besoins et des comportements, des autonomies, des micro-révolutions partielles).
De ce schéma de discours naît une hypothèse de théorie de l’organisation « après le déluge » (qui a donc traversé le terrain de la critique radicale de la politique et des formes d’organisation).
Commence à se configurer une conception du parti comme unité des multiples, capable d’incorporer en son sein la richesse des « langages » du mouvement. On pourrait paradoxalement appeler « nécessaire arrière-garde organisée » ce parti qui ne serait pas « à une seule dimension » : une forme d’organisation qui serait – en même temps – parti politique, parti social, parti-guérilla.2
LES FORMES D’ORGANISATION EXISTANTES COMME MAUVAISES APPROXIMATIONS D’UN SUJET MODERNE DE PARTI
Par rapport à ce niveau de problèmes, l’état actuel de la « subjectivité » est incroyablement arriéré.
L’histoire des expériences d’organisation – reproduites dans le laboratoire de ces dernières années – a été celle de la détermination systématique d’une série de mauvaises approximations. Examinons-les.
Le « parti révolutionnaire » devrait être, par définition, liberté de la tactique. À présent, la conception légaliste d’un côté, et de l’autre la conception militariste du « principe organique » du parti – se configurant toutes deux, symétriquement, comme hypothèses à une seule dimension – ont empêché que cette liberté se réalise.
Nous pouvons aujourd’hui vérifier également sur une base empirique l’échec des théories de l’organisation unilatérales (ou pour mieux dire, uni-dimensionnelles) :
– Une conception pacifiste-légale du parti, ne reconnaissant pas le caractère organiquement politico-militaire de la décision capitaliste, contournant le noeud de l’État et donc de sa destruction – le problème du pouvoir et donc de la guerre civile -, porte inévitablement à « couper haut » les contenus programmatiques mêmes du mouvement, excluant ceux incompatibles avec une « solution négociée », avec une médiation revendicative et/ou politique.
Naturellement, entre légalisme/pacifisme et réformisme le rapport cause-effet se configure dans les deux sens : limite revendicative et médiation institutionnelle sont quand même l’expression d’un légalisme de fait par rapport à l’État.
– Une conception linéairement et classiquement insurrectionnaliste – voyant dans la guerre une variable « éventuelle » (liée entre autres à une théorie endogéniste de la crise, conçue – dans un style principalement sous-consumériste – comme effondrement par l’effet des contradictions internes au mécanisme capitaliste, et non comme résultant de la contradiction fondamentale représentée par l’offensive ouvrière) – voit le caractère combattant de l’organisation, son travail militaire, comme un appendice « exogène », secondaire, temporaire, marginal, éventuel. Devant la caducité d’une hypothèse « catastrophiste », basée sur l’avènement d’un extraordinaire et exceptionnel concours de circonstances qui présente sur un plateau d’argent l’occasion révolutionnaire, l’unique contenu réel, effectif, du dualisme lié à l’hypothèse insurrectionnaliste a été, est toujours, l’absolu privilège accordé au versant politique de la dualité (ou si l’on préfère le prolongement indéterminé du premier des « deux temps »).
– Une conception organiquement guérillériste, pour sa part, n’utilise pas (ou sous-utilise) le formidable avantage dont une organisation qui incorpore parmi ses éléments constitutifs le principe organique du combat (combattimento) – prédestiné à la conduite de la guerre – peut user : la liberté de la tactique sans limites « par le haut », la possibilité d’opposer à la richesse et la multiplicité des fonctions capitalistes autant de richesse et de multiplicité de fonctions, de tactiques, de formes de lutte.
En n’appréciant pas la puissance possible d’un usage combiné de tactiques et de formes de lutte diverses, cette approche sous-dimensionne sa propre efficacité révolutionnaire (ou même seulement subversive).
Ce que nous avons appelé « liberté de la tactique » – formidable conquête que les formations combattantes (« armées », « politico-militaires », « terroristes », « guérilléristes », ou comme on veut les appeler) ont réalisé pour tout le mouvement – a été sous-utilisé du fait que la pratique combattante a été – paradoxalement – isolée du magma du mouvement, comme renfermée dans une « chambre stérile ». Dans la vie des formations combattantes – coincées par le dualisme entre spécificité opérationnelle et « morale révolutionnaire », entre ingénierie d’organisation et idéologie de la révolution – la forme de l’organisation, le plus souvent, a fini par prendre le pas sur la substance de la révolution.
UN « DÉJÀ DIT » TOUJOURS ACTUEL : LE CARACTÈRE COMBATTANT DE L’ORGANISATION COMMUNISTE ET DE SA PRATIQUE EST UNE CONDITION NÉCESSAIRE, MAIS NON SUFFISANTE POUR EN DÉFINIR LA VALEUR, L’EFFICACITÉ RÉVOLUTIONNAIRE
Le mécanisme de cristallisation idéologique que nous avons observé tend à se vérifier dans les organisations combattantes, porte à oublier l’énoncé selon lequel le travail révolutionnaire n’est pas réductible à la guerre (qui en est, toutefois, une variable décisive) ; et la guerre – à son tour – n’est pas réductible aux aspects militaires de celle-ci, et encore moins à ce « moment » particulier qu’est le combat. Énoncé dont découle que le travail révolutionnaire est un travail combiné, complexe. Il s’en suit que le caractère combattant de l’organisation communiste et de sa pratique est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour en définir l’effective pertinence révolutionnaire.
– L’unilatéralisme militariste, en revanche, resserrant la pratique réelle, la science réelle de l’organisation aux aspects militaires, réduit l’organisation à une « machine simple », subalterne à l’intelligence complexe du côté capitaliste.
– L’uni-dimensionnalité militariste, niant le principe de la division du travail, de la multi-dimensionnalité, de l’interfonctionnalité, de l’unité des multiples et des différences, nie la possibilité d’une coopération transversale, rive l’organisation à un stade primitif, à un niveau de travail simple, de pratique artisanale.
Au fond de l’uni-dimensionnalité militariste on découvre son caractère – en définitive – anarchique : se trouve en fait théorisée l’utopie selon laquelle chaque parcelle d’organisation peut et doit posséder la synthèse d’ensemble : mais alors – peut-on immédiatement objecter – la coopération est inutile, division du travail et discipline sautent, les particularismes se trouvent exaltés, une dynamique micro-fractionniste continue triomphe, qui produit une segmentation « à l’infini » du patrimoine organisationnel, jusqu’à le diviser en parcelles centésimales.
Si chaque micro-fraction, chaque parcelle d’organisation, à la limite chaque camarade singulier, trouve en soi sa propre vérité, sans autres critères de vérification (ou presque) minimalement « objectifs », le destin frustrant de la segmentation / re-composition continue se répète – évidemment à l’infini.
– L’uni-dimensionnalité militariste provoque une auto-identification dont le déterminant est le contenu concret du travail particulier que l’organisation exerce : c’est-à-dire une auto-identification, au fond, comme corporation. (L’utopie selon laquelle l’entièreté des fonctions et une synthèse du travail « complexe » doit être possédée de manière égale, homogènement distribuée, par chaque molécule singulière, chaque parcelle d’organisation, fait que se produit une attitude pour laquelle la coopération transversale est méconnue, la puissance d’ensemble est sous-évaluée, et chaque micro-organisme partiel – « repu de soi-même » – est disposé à chaque pas à rompre la machine complexe d’une organisation du travail révolutionnaire, car il voit l’insertion dans un organisme transversal comme une pure limitation de sa propre liberté et capacité d’auto-gouvernement.)
– L’uni-dimensionnalité militariste sous-évalue, rejette et supprime le problème de la socialité, qui veut dire aussi l’intelligence (qui veut dire, à son tour, létalité contre l’ennemi).
– La simplification militariste finit par penser pouvoir synthétiser dans le « mono-langage » de l’action militaire la richesse du mouvement. En réalité le mouvement et les noyaux d’organisation communiste révolutionnaire qui y vivent devraient avant tout, désormais, avoir découvert que la question de la force, de la violence et de sa forme militaire n’épuise pas la richesse complexe du travail révolutionnaire.
– L’uni-dimensionnalité militariste sous-évalue le problème de la direction politico-programmatique de sections de classe, de mouvements entiers, le travail de formation d’un bloc politico-social capable d’incarner dans une période historique déterminée les éléments vivants de la tendance communiste : un bloc qui se fait donc élément promoteur de la rupture révolutionnaire (comme étape de « grande tactique » à l’intérieur de la stratégie – générale et spécifique – de l’émancipation / libération prolétaire). De cette sous-évaluation dérivent deux possibles conséquences : ou bien le problème de la construction d’un bloc révolutionnaire tactiquement déterminé se trouve renvoyé au caractère forcé d’une unification de classe qui se ferait sur le terrain de la résistance ; ou bien alors tout se trouve renvoyé exclusivement aux processus d’auto-organisation de la subjectivité de classe. La subjectivité de classe – le mouvement du communisme naissant – est, au contraire – à notre avis – certes stratégique, mais incapable de se coaguler autour de raisons, nécessités et modes d’un stade de « grande tactique » comme celui de la révolution politique : c’est là que se détermine le rôle d’une variable subjective organisée.
– L’unilatéralisme militariste, enfin, a eu – parmi ses effets apparus au cours des dernières années – celui de frustrer le développement politique, et de bloquer l’expansion organisationnelle même des processus d’organisation révolutionnaire. Une forme d’organisation simple, uni-dimensionnelle, est en réalité la moins « anonyme » de toutes : à chaque fois qu’elle prend l’initiative, elle est contrainte d’exhiber sa nature entière, et de l’exposer à la « recherche et destruction » de l’ennemi : elle est donc continuellement contrainte de choisir entre paralysie politique et aventurisme organisationnel.
Ce qu’il faut en revanche, c’est une grande richesse, une grande, large multiplicité de formes, d’expressions et d’actions.
C’est la perte de cette capacité, de cette ductilité, de cette tension affranchie de l’efficacité révolutionnaire, avant tout, qui est le revers de la médaille des expériences des organisations armées. Il est rageant de penser que – une fois déchirée la cape de la contrainte légaliste, la frustrante liberté limitée que le « toit » légaliste impose à la lutte – l’aile radicale du mouvement se soit enfermée dans une nouvelle (cette fois volontaire) prison.
Examinons plus à fond la question : l’insistance sur un réquisit d’homogénéité théorico-pratique (de l’ensemble du « sujet » d’organisation, aussi bien que des éléments constitutifs singuliers) ; la reconnaissance de la nécessité d’une formation transversale et polyvalente, d’une interchangeabilité et multi-dimensionnalité des cadres, ont été au centre des propositions théorique et des directives pratiques qui ont présidé à la constitution des formations de matrice guérillériste au cours des années passées. Ce discours aurait eu du sens s’il avait été théorisé et proposé comme discours sur le « groupe dirigeant », comme théorie spécifique de la constitution du noyau promoteur central – ou mieux : des noyaux promoteurs centraux – de l’organisation révolutionnaire (ainsi qu’elle se configure « à l’époque du mouvement de l’actualité du communisme »). Appliqué en revanche de manière indifférenciée à la définition et à la sélection de tout le corps militant (de l’ensemble des « cadres », de la totalité du « personnel politique » révolutionnaire), le discours sur l’homogénéité et sur le caractère transversal du cadre s’est transformé en une conception absolument unilatérale. La complexité est restée lettre morte, l’aspect militaire – devenu omnivore – a tout assimilé à soi. Il en a découlé une nature, un mode d’être subjectiviste et intégraliste.
S’est déterminée une déformation spécifique pour laquelle – dans la plupart des micro-fractions révolutionnaires de ces années – les règles statutaires et les codes de fonctionnement ont été subrepticement transformés en théorie de l’organisation, voire en « vademecum de la révolution ».
L’idéologie de l’uni-dimensionnalité militariste a fini par affirmer que le caractère politico-militaire de l’affrontement devait informer en soi chaque fonction, chaque aspect du travail, chaque forme d’organisation, chaque cadre, chaque « journée de travail » du militant révolutionnaire. Cette homologation forcée, cette continue et obsessive « reductio ad unum », cette violente simplification intégraliste a fini par stériliser la pratique révolutionnaire. La pratique combattante est devenue très souvent l’extrême et acritique reproposition de l’univers des séparations totalisantes.3
Le terme « combattant » n’a pas été correctement entendu au sens de « prédicat nécessaire et fondamental du Parti » (c’est-à-dire entendu comme sa condition, sa caractéristique, son attitude, sa capacité – dont dérive une tactique, une forme d’action). Non, avec ce terme les formations guérilléristes aujourd’hui existantes désignent un « statut » organique, intégral, une nature fondamentale (qui dans les faits, par son caractère omnivore, finit par devenir l’unique forme d’existence et d’expression « de parti »).
En somme, les formes d’organisation guérilléristes existantes refusent l’un et l’autre aspects de l’alternative possible que nous avons indiquée : ou bien se poser comme section d’un parti transversal (donc aussi combattant), ou bien se poser comme fonction d’un mouvement transversal, qui possède quasi toutes les prérogatives qui auparavant se trouvaient hypostasiées dans la forme-Parti.
En écartant l’une et l’autre de ces propositions – celle que nous avons définie comme « néo-léniniste » et celle que nous avons appelée « néo-guérillériste », les formations combattantes risquent de conjuguer, avec de mauvais résultats, « vétéro-léninisme » et « militarisme ».
Certes, certaines formations organisées de l’aile radicale, subversive, du mouvement, n’ont pas théorisé l’uni-dimensionnalité ; mais une ambiguïté, une timidité sur ce terrain, une sujétion idéologique aux propositions guérilléristes pures sur le terrain de la théorie de l’organisation a fait qu’on finit de fait par renoncer (même avec beaucoup de corrections et de « contre-poids » compensatoires) à ce caractère « hybride », d’organisme multilatéral, transversal, qu’une hypothèse de matrice néo-léniniste devrait proposer comme qualité fondamentale de l’organisation révolutionnaire.
De cette forme possible d’organisation transversale n’a pas été suffisamment mise en évidence l’originalité, la différence. Au contraire ce modèle – que nous venons d’appeler « néo-léniniste » – est apparu à la majorité des camarades comme « tiers-forciste », comme médiation et/ou syncrétisme entre deux tendances : le dualisme du modèle tiers-internationaliste classique, et l’unilatéralisme du modèle guérillériste. Ainsi, les expériences, les tentatives qui ont évolué dans cette direction ont toujours subi un double effet : d’écrasement et de lacération.
On peut en dire autant des formes de lutte. Une réflexion non idéologisée sur les « variables » du mouvement comme elles se sont présentées ces dernières années porte à conclure que la pratique combattante – si elle s’autonomise d’une « projectualité sociale » d’ensemble, si elle perd un lien de référence continu, constant à sa finalité révolutionnaire, si elle n’est pas continuellement recalibrée par rapport à la nécessité d’en faire un instrument efficace de la transformation sociale, de la libération communiste – finit par devenir une sorte de « créature monstrueuse » de la volonté révolutionnaire.
Ces choses, ces vérifications, ces arguments critiques, les sujets réels qui peuvent guider le processus de fondation d’une fonction guérillériste stable à l’intérieur du cadre de l’affrontement de classe, doivent-ils les penser et les dire ouvertement, ou bien doivent-ils les refouler et/ou le susurrer dans la « salle caritatis », laissant à la droite du mouvement le loisir de pouvoir les utiliser d’un point de vue pacifiste et – au fond – légaliste ?
ENCORE UNE FOIS, SE MOUVOIR À CONTRE-COURANT : SE LIBÉRER DE TOUTE SUJÉTION AU REGARD DES « IDOLES DU TEMPLE », DES LIEUX COMMUNS DU MOUVEMENT
Pour l’aire qui, ces dernières années, a évolué sur le terrain de l’initiative armée, il est aujourd’hui plus que jamais vital (et inévitable) de libérer la théorie et la pratique combattante de la misère de l’idéologie militariste, de l’affranchir du sous-dimensionnement auquel le militarisme contraint la « lutte armée ». Alors, ou l’on retient que ce processus d’auto-correction est possible, ou alors on est obligé de conclure que ces formes de subjectivité organisée – étant irrémédiablement dominées par une logique d’auto-reproduction comme classe et, à la limite, comme « corporation professionnelle » particulière – sont condamnées à une stérilisation progressive, engagées dans une histoire de complète auto-suffisance et d’indépendance vis-à-vis du « chemin de la révolution », en tant qu’ensemble complexe et choral des processus de transformation sociale. La conscience diffuse de l’irréversibilité d’une tendance à la guerre civile révolutionnaire (ou, plus simplement, la conscience du fait que la lutte armée est désormais une variable solidement implantée dans le champ de l’affrontement) ne peut pas ne pas déplacer le « tir » du débat des révolutionnaires ; elle doit absolument en requalifier les contenus.
Il est indéniable que presque une décennie après que fut ouverte une dure bataille, tendant à imposer au sein du mouvement – et avant tout dans ses fractions d’avant-garde – le privilège du mot d’ordre de transformation du cadre militant en cadre organiquement combattant, l’objectif de libérer la pratique révolutionnaire du sortilège maléfique des illusions gradualistes et de la « contrainte légaliste », a été accompli. Il existe désormais dans ce pays un « levier » de cadres combattants qui, tout en n’étant pas encore un fait de masse, est tout de même – dans ses infinies bigarrures, dans son développement différencié et inégal – une aire socialement diffuse, solidement présente dans le corps social, dans les cellules vitales de la société productive : dans les usines, les territoires prolétaires, dans des secteurs significatifs de l’intelligentsia techno-scientifique.
Cela ne veut pas dire que les formes d’organisation et d’action proto-guérillériste – ou, si l’on veut, le terrorisme diffus – sont sorties du ghetto du minoritarisme, conquérant une épaisseur « majoritaire ». En fait, à regarder le mouvement réel sans lentilles idéologiques, le fait est que – en dépit des idéologies, des modèles, des « résolutions stratégiques », des éléments de formalisation, des codes de fonctionnement, des statuts – l’ensemble des formations combattantes est devenu « mouvement », variable et fraction extrême du mouvement général. La pratique combattante s’est affirmée :
– Comme une « idéologie pratique » renvoyée par une ossature militante à des zones particulièrement radicalisées de l’univers social.
– Comme un phénomène résultant de multiples causes (du jacobinisme de la politique révolutionnaire à l’immédiatisme radical de la critique de la politique).
En somme la lutte armée a été tout sauf une tactique de parti, et l’ensemble des formations combattantes a été bien loin de se poser réellement comme un processus de parti avec des caractéristiques matures.
Ce qui, de toute façon, est certain, est que ce réseau est capable de se reproduire, synthétise en soi une large gamme de motivations et d’arguments, possède une pluralité de codes génétiques qui en assurent les mécanismes de reproduction, plus véloces et diffus quoiqu’il en soit, que le « pas » de la répression.
Donc la création de cette « armée invisible » de prolétaires, de communistes, ne peut plus être pour quiconque un objectif, un mot d’ordre, un résultat à atteindre. Ce tissu existe et n’a certes pas besoin d’être inventé, promu, alimenté. À ce stade, le problème des révolutionnaires devient, non son existence, mais sa qualité – soit la direction, le destin politique, le « sens de la marche » de cette tendance, sa plus ou moins grande pertinence et efficacité révolutionnaire. À ce stade il n’est plus à l’ordre du jour de « choisir son camp » quant aux formes (disons plutôt à la forme qui devient peu à peu dominante) de la lutte. Le problème d’aujourd’hui est qu’à cause de son « taux » de mauvais idéologisme, ce « mouvement », cette tendance vers la guerre civile révolutionnaire, se lie soi-même les mains, est la source de son propre sous-dimensionnement, de sa propre stérilisation.
Alors, si les sujets qui ont été et sont protagonistes de cette tendance ne prennent pas conscience de la nécessité d’une rectification d’une portée telle qu’elle puisse être définie comme une véritable refondation, ce « phénomène » est destiné à « tourner en rond » sur soi-même, inutilement et impuissamment.
Ces choses sont dites avec clarté, sans timidité et sans complexes.
Aux « sages » qui les trouvent pléonastiques car ils les savent depuis toujours, il faut répondre que le mouvement et la chaire dont viennent ces objections ont de l’importance en vue de leur efficacité. Aux camarades « agités » – qui croient compenser le vide de perspective et les difficultés de compréhension du réel avec un « serrons-nous en cohorte », avec une idéologisation de type intégraliste et une complaisance pour sa propre forme spécifique d’expression qui ressemble tant à cette identification au « métier » typique des corporations artisanales – il faut répondre que, sans cette conscience, aucune réunification entre leur pratique et le concret du processus de transformation n’est possible.
La possibilité de se libérer du taux d’intégralisme, de bigoterie, d’arrogance idéologique que les expériences d’organisation construites sur le terrain de la lutte armée ont jusqu’à maintenant traîné derrière elles, requiert une méthode de débat moins conformiste, moins « respectueuse », plus dénuée d’hypocrisie, de tacticismes et de complexes.
ÉLÉMENTS PRÉLIMINAIRES POUR UNE THÉORIE PRATIQUE DE LA FORME-PARTI
Si nous « tenons pour valide » l’ensemble de ces observations, il en résulte que – à l’intérieur de certaines coordonnées – il sera à nouveau possible de parler de forme-Parti (quoiqu’il en soit subordonnée à un primat du mouvement comme sujet communiste de masse en voie de formation) quand sera théoriquement et pratiquement fondée une synthèse d’expériences significatives en mesure de se produire comme gouvernement d’une unité de différences.
Nous parlons en d’autres termes d’un sujet qui saurait apprécier, user, se dialectiser avec la spécificité, la division du travail, la multiplicité contradictoire des langages, sans vouloir tout court-circuiter en une synthèse forcée et simple produite à l’intérieur du petit groupe, du fragment singulier de l’agir, voire du camarade singulier.
En observant les choses à partir des critères ci-dessus exposés, on peut voir que de cette revisitation du problème de l’organisation nécessaire peuvent dériver deux voies (qui sont – soit dit en passant – toutes deux absentes du panorama des organisations actuellement existantes) :
a) Une hypothèse organiquement guérillériste, épurée cependant de tous les déchets idéologiques « paléo » et « vétéro », des étroites super-simplifications tiers-mondistes, des schématismes « kominformistes-tardifs », des résidus d’idéologie populaire et socialiste, et avant tout de la fausse conscience de Parti (c’est-à-dire de cette subreptice prétention à la totalité qui vit comme une inutile prothèse accrochée à la réalité partielle de la pratique guérillériste).
Cette hypothèse naît d’un ensemble de considérations à la base desquelles on retient comme désormais impossible un quelconque rôle de la subjectivité autre que la préparation à cette pré-condition fondamentale de la transformation révolutionnaire qu’est la guerre civile.
Il s’agirait en somme d’une hypothèse qu’on pourrait définir – en un certain sens – comme hyper-guérillériste. S’auto-identifiant ainsi, se proposant dans la richesse de sa pratique partielle, et non dans la misère d’une subreptice et seulement apparente totalisation « de parti », le sujet guérillériste – libéré de la fausse conscience de parti – se reconnaîtrait comme sujet tendanciel, particulier, qui a une fonction d’appropriation continue de savoir théorico-pratique – et un rôle conséquent de direction – sur les aspects militaires du processus révolutionnaire (au sens large : c’est-à-dire incluant toutes les phases « en amont » et « en aval » de l’hypothétique « point critique » lors duquel – au cours de la guerre de classe – la « part majoritaire » du pouvoir se transfère vers le camp prolétaire).
Il n’est pas difficile de voir comment – corrigeant leur traditionnelle erreur de « métonymie », envisageant lucidement le partiel comme partiel, se libérant de l’encombrant « surmoi » qui s’exprime comme fausse conscience de Parti – les sujets guérilléristes possibles pourraient retrouver une richesse, une « légitimation » comme articulation consciente d’une fonction spécifique de mouvement.
Cela voudrait dire se reconnaître comme partie d’un bras armé (absolument « sui generis » car auto-déterminé et donc relativement indépendant) du mouvement. Celui-ci serait correctement considéré comme pluri-sujet « stratégique » de la transformation sociale – dont la « lutte armée » serait vue comme une variable stratégiquement dépendante (et tactiquement indépendante).
b) La seconde est une hypothèse – que l’on pourrait appeler néo-léniniste (ou à certains égards hyper-léniniste) de parti comme sujet transversal, pluri-fonctionnel, dans lequel un « noyau promoteur » central – théoriquement et pratiquement homogène, polyvalent, composé de sujets « interchangeables » et autant que possible « complets », capable de gouverner théoriquement le multiple, promeut et innerve un faisceau de fonctions hautement diverses, qui au cours de leur développement accentuent cette diversité.
C’est cette diversité qui se trouve ensuite reconduite à une unité de projet général. Mais cela ne peut certes pas être l’apanage exclusif d’un sujet de parti. Surtout en phase embryonnaire, c’est le résultat d’une lutte continue, d’une tension projectuelle : rien n’est jamais – sur ce terrain – donné de manière irréversible.
PREMIERS ÉLÉMENTS POUR UN DÉBAT SUR LES « MODÈLES » : L’UNITÉ DES MULTIPLES COMME RÉQUISIT MINIMUM
Si nous devons penser à un « modèle » adéquat à ces éléments très généraux identifiés comme premières coordonnées utiles à définir une forme-Parti moderne, « après le déluge », on devrait penser à une inter-fonctionnalité évoluée, dont les « pointes » les plus avancées du débat ne font aujourd’hui entrevoir que les coordonnées minimales :
– Une fonction verticale, offensive, indépendante, préposée à l’exercice d’une capacité d’interdiction et de désarticulation du macro-savoir / macro-pouvoir capitaliste, destinée à l’ouverture d’espaces pour l’affirmation des processus émancipateurs. Une capacité, en somme, d’interdire le pouvoir d’interdiction qui empêche le développement de tous les éléments d’intelligence sociale projectuelle, les nouvelles formes de « communication sociale », les embryons d’une coopération sociale libérée, incomparablement supérieure à celle organisée dans la forme sociale capitaliste.
– Une fonction « horizontale », synthétique, préposée à l’intervention dans la composition politique de classe, à l’affirmation du contre-pouvoir sur le territoire. Les déterminations concrètes de cette fonction devraient naturellement innerver les processus d’organisation de la « subjectivité de la classe » (organismes politico-révolutionnaires versus « instituts du pouvoir »). Cette fonction devrait pour toute une période agir sur le terrain de la médiation programmatique de comportements et de mouvements de lutte autonomes (non sujets à compatibilité – absolue ou relative – avec le système) et pourtant situés en deçà d’une rupture radicale ; visant au déplacement – pas encore au renversement – des rapports de force ; attestés sur le terrain de la dynamique politico-sociale – pas encore sur le terrain de sa radicale, irréversible ratification en termes de guerre civile.
– Une fonction verticale expansive, particulièrement attachée au terrain de la critique de la politique (ou, plus précisément, de l’impact entre pratique émancipatrice mise en œuvre par l’antagonisme prolétarien et univers du « politique »). Il s’agit en d’autres termes d’une fonction adéquate à une bataille pour le sabotage et l’évacuation de l’autonomie du politique, visant à bouleverser et radicalement transformer le « sens commun social ».
Il est clair que la poursuite de la critique de la politique – en se réappropriant toutes les fonctions – détruira également cette séparation résiduelle ; mais à ce niveau aussi se maintient – nous le croyons – la nécessité d’un jacobinisme résiduel, d’une « incursion » sur ce terrain encore séparé, sur ce terrain de la formation d’une strate encore « spécialisée » qui opère sur le terrain de la critique de la politique. Il s’agit, certainement, d’une contradiction dans les termes : mais il nous semble malgré tout que contre « l’autonomie du politique » il faut une articulation politique, spécifiquement politique. Cela est un discours très hasardeux : nous voulons en débattre.
Nous affirmons la nécessité de mettre en crise, de dépasser théoriquement et pratiquement les formes d’organisation existantes.
Ceci n’est pas un problème « méthodologique » ou « de principe » ; c’est une question absolument de fond, tout à fait spécifique et pertinente au regard de la phase qui s’ouvre.
De toute évidence ce qui nous intéresse ici – et de manière générale dans toute cette intervention – c’est la critique des organisations de l’aire subjectivement révolutionnaire, qui nous concerne et nous implique de près.4
Nous pouvons dire aujourd’hui qu’une des conditions premières de la construction d’un processus d’organisation générale est le dépassement drastique des micro-fractions actuelles. Apparaît aujourd’hui singulièrement lumineux et illuminant le discours marxien sur le caractère d’alternative radicale qu’au regard des « sectes » avait la construction de l’Internationale.
QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE CARACTÈRE CONSERVATEUR DES « MICRO-FRACTIONS »
La première donnée émergente est la présente « inadéquation » des formes d’organisation actuelles. Se met toujours plus en évidence une disproportion entre misère des formes subjectives et complexité/grandeur des faits sociaux. De la conscience de cette inadéquation, de cette disproportion naît – entre autres – la crise d’identité et de motivations latente qui touche (justement maintenant que s’ouvre une saison heureuse pour l’antagonisme de classe) des secteurs significatifs du tissu militant.
Les micro-fractions organisées existantes ont en fait peu à peu perdu de leur fonctionnalité révolutionnaire. Inutile de reparcourir ici une procédure descriptive traitée ailleurs : il suffit de dire que le politicardisme, l’unilatéralisme militariste, la religion apologétique des formes de lutte, le verbalisme, l’identification acritique avec l’univers indiscriminé des comportements extrémistes et autres maladies ont profondément miné le caractère révolutionnaire des formations organisées actuelles.
Si on nous demande si les formes d’organisation subjective sont aujourd’hui « plus avancées » ou « plus en retard » par rapport au mouvement, si elles ont aujourd’hui un rôle effectif d’avant-garde, ou si elles sont au contraire de grisâtres instituts de notaire du mouvement, parasitaires à son égard, objectivement fonctionnelles à en retarder les éléments de maturation et de radicalisation, il n’y a rien à répondre qui vaille le second jugement.
Aujourd’hui c’est ainsi : les « micro-fractions révolutionnaires » – nous n’avons aucune complaisance à le relever – sont au nouveau mouvement ce que « les poux sont à la baleine ».
Un « signal » significatif est la gêne croissante dont font preuve les micro-fractions en général vis-à-vis des formes émergentes et inédites de la spontanéité. Ces camarades font penser au poème de Brecht à propos de la révolte ouvrière de Berlin en 1953 (…« le peuple a violé les décrets du comité central ? Il faut donc changer de peuple »…).
C’est ainsi qu’un léninisme caricatural s’éloigne du noyau vivant de la tactique léniniste, qui est la capacité d’interpréter, rassembler, orienter la spontanéité vers ce moment de « synergie décisive » capable de déterminer la rupture.
– Le cas de la lutte des « hospitaliers sauvages » vaut comme exemple d’actualité utile pour éclairer le rapport entre micro-fractions révolutionnaires et mouvement.
Le fait que les formations organisées, plus ou moins formelles, ont été vis-à-vis de la lutte des hospitaliers de purs appendices parasitaires, est sous les yeux de tous. Plus encore : ils ont eu une attitude de sous-évaluation systématique, de refoulement des implications « stratégiques » de cette lutte. Pour ne pas être remis en cause, critiqués radicalement dans leur rôle et leur idéologie, ils ont « regardé sans voir ». Ils ont regardé avec une lentille inversée, ils ont interprété le refus spontané de la « colonisation » politique, exprimé par les hospitaliers en lutte, uniquement dans son aspect d’arriération pré-politique. Ils n’en ont pas saisi, même minimalement, la seconde nature, post-politique, de « critique des formes politiques existantes ».
– Il y a un deuxième exemple : celui des « petits groupes ». De quoi s’agit-il ?
L’élément simple, centésimal, le point d’arrivée d’un processus de segmentation, de fragmentation « ad infinitum » des sujets organisés, a été durant ces dernières années le « petit groupe » – pour ainsi dire, social.
Ces molécules sociales se sont assemblées sur la base du rapport de travail ou d’école, « coude à coude », des expériences de quartier, d’une milice commune précédente, des différentes formes de vie collective qui se sont produites et reproduites au sein du mouvement ces dernières années. Bien : l’apparent paradoxe de la situation est que dans ces petits groupes vivent souvent des « cristaux » d’intelligence (partielle), de force d’invention subversive / appropriatrice que les micro-fractions ont presque totalement réprimé et aplati. Nous disons cela sans aucune complaisance : le fait est – que cela plaise ou non – qu’il y a aujourd’hui beaucoup plus d’imagination sociale dans le « petit groupe » que dans la forme-micro-fraction.
– Il y a une troisième remarque : si l’on observe « à l’oeil nu » – sans les lentilles de l’idéologie et/ou du triomphalisme – l’histoire des « organisations révolutionnaires » ces dernières années, on peut noter que le modèle classique du « centralisme démocratique » a été appliqué de manière forcée à un organisme petit et frêle comme celui des micro-fractions. On peut aujourd’hui tirer la conclusion que conjuguer idéologie et pratique du centralisme avec un tissu organisationnel faible (et en outre profondément segmenté) a signifié – nous pouvons maintenant l’affirmer avec une suffisante certitude expérimentale – produire des monstres, poser les bases d’une rapide dégénération des organisations en « racket ».
Sur tout cela il faut réfléchir, comprendre à fond (et démontrer pratiquement qu’on a compris) beaucoup de choses. Le besoin de transformation est profond, total. Des milliers de sujets différents du mouvement le crient à la face des « sujets organisés ».
Loin de toute sanctification du mouvement, nous disons que cette fois-ci ils ont raison. Dans l’enchevêtrement ambigu entre éléments post-politiques (de critique de la politique) et régressions pré-politiques – éléments qui cohabitent toujours, étrangement symbiotiques, dans les mouvements émergents – on peut dire qu’aujourd’hui prévaut la conscience de l’actualité du thème de la fin de la politique, de la possible imminence de son dépassement de la part d’une gigantesque pratique communiste intégrale, libératrice. Cette tendance vit, même de manière confuse, dans les nouveaux mouvements.
Il n’y a dans ces observations aucune angoisse « moderniste » ; aucune complaisance, tentative « guépardesque » de se repeindre à neuf ; aucun reluquage du mouvement tel qu’il est ; aucune volonté d’adorer les « idoles du temple » de la dernière heure ou de la dernière mode culturelle ; aucune angoisse de se recycler et – le rite de l’autocritique et de la « remise en cause » accompli – de revenir à porter comme si de rien n’était les vêtements de la fête.
Ainsi, le premier phénomène dont il faut se protéger est le travestissement de qui – dans l’assomption démagogique et fourbe des aspects les plus superficiels et folkloriques de cette critique des formes politiques – entend faire passer subrepticement des contenus de ligne précis. C’était et c’est toujours le cas de l’indianisme hypocrite qui avait imprégné en 1977 la gauche semi-institutionnelle – jusqu’à l’honorable Corvisieri – et qui avait été utilisé à pleines mains pour diffuser dans le mouvement une idéologie démocratique-pacifiste. C’est le cas du quotidien « Lotta Continua » qui depuis pas mal de temps utilise à sens unique l’outillage conceptuel de la critique de la politique, de la critique du révolutionnarisme professionnel ; à sens unique – c’est-à-dire seulement contre le jacobinisme révolutionnaire, et bien peu – ou jamais – contre les formes « pacifiques » de la médiation politique. C’est le cas des « nouveaux philosophes », du « staff » craxien de Via Tomacelli qui récupèrent dans une intention purement instrumentale les thématiques du courant libertaire et des oppositions de gauche vis-à-vis du Mouvement Ouvrier majoritaire – tant il est vrai que leur critique du « socialisme réel » est totalement faussée et falsifiée dans un style idéologique anti-marxiste et anti-léniniste, et oblitère complètement la critique du contenu capitaliste du « socialisme réel », de même qu’elle oblitère la critique des autres formes – passées et actuelles – du despotisme capitaliste.
Non, le point de vue de la critique radicale n’a rien à voir avec ce bric-à-brac. Quand nous exprimons une critique totale des formes d’organisation existantes, dans notre discours il y a seulement la conviction – pas du tout complaisante et tout compte fait amère – que les choses sont véritablement ainsi.
CONTRE LES MICRO-PARTIS RÉALISÉS
De quoi dérive cet ensemble de graves « maladies de la subjectivité », voilà qui est matière à débat : « mais à quoi sert, aujourd’hui, de se reprocher les injustices et les torts réciproques ? »
Ce qui est sûr c’est qu’il est inacceptable d’imposer aux processus d’organisation un « trend » accéléré vers la centralisation, quand la synthèse que cette centralisation sous-tend est absolument pauvre et inadéquate.
Le léninisme formel que beaucoup agitent avec un enthousiasme de néophyte est profondément ennemi d’une possibilité de revitaliser, en le revisitant, le noyau vivant d’un léninisme substantiel.
Aujourd’hui la chose la plus ennemie d’une bataille pour l’organisation est de soutenir la théorie des micro-partis réalisés (que ce soit dans sa variante hégémoniste ou agrégative). La question du Parti comme possibilité mature n’est aujourd’hui pas à l’ordre du jour.
Le problème d’aujourd’hui est de se mouvoir entre les deux pointes du problème :
– D’une part il y a la nécessité pratique de supprimer du chemin possible du processus organisationnel les formes résiduelles d’organisations actuellement existantes, réduites – si elles ne se transforment pas – à devenir des débris qui font obstinément obstacle au développement politico-organisationnel général.
– De l’autre il faut éviter une « diaspora » de cadres qui disperserait et rendrait vaine la richesse d’un vaste patrimoine militant qui s’est formé et a agi ces dernières années.
Cela – le maintien et la requalification d’un patrimoine de cadres et de « savoir-faire » militant – est l’unique continuité possible.
Des formes, il y a peu ou rien à sauver.
Probablement, l’unique forme d’organisation qu’il est réaliste d’envisager – à ce niveau de maturité du rapport subjectivité séparée / subjectivité de classe – est une forme de centre d’initiative, de noyau promoteur, qui promeut, innerve, traverse et rassemble le faisceau de fonctions indiqué plus haut.
Aujourd’hui un centre communiste promoteur de travail révolutionnaire ne peut être le « lieu » d’une synthèse/centralisation organique exercée sur cette multiplicité de fonctions possibles ; il peut-être en revanche une intelligente et agile « chambre de compensation » qui stabilise un rapport d’interaction avec les éléments d’autodétermination des fonctions, exerçant un rôle critique pour en révéler la partialité, et pour promouvoir concrètement les éléments de synthèse partielle.
La réalité des processus en cours fait penser qu’iront se coaguler (par lignes d’orientation, par tendances, par propositions de lignes de conduite) des « fronts » qui traversent/dirigent le moléculaire et difforme univers des subjectivités données.
Tout cela va dans une direction radicalement différente de celle éclipsée par d’autres propositions : par exemple l’hypothèse du « parti pluraliste de l’autonomie ». Un beau nom, il n’y a pas à dire ; mais franchement cela nous semble – et nous le regrettons – être du vent.
En premier lieu cette proposition était déjà tardive quand – le printemps dernier – elle a été avancée. En second lieu elle était adressée à l’autonomie résiduelle plutôt qu’à celle possible. C’était – à bien y regarder – une proposition conservatrice : l’organisation y apparaissait comme remède au reflux, plutôt que comme décisive augmentation de puissance et d’intelligence de l’offensive. Du point de vue du débat sur la « théorie de l’organisation » cette proposition est « morte-née » puisqu’imprégnée d’un plat continuisme. Elle évoluait dans le règne de l’homologie, elle tendait à abolir toute dialectique réelle entre mouvement et sujet « de parti », proposant une subsomption du mouvement dans l’organisation et un aplatissement de la « subjectivité » sur le mouvement. On pouvait en tirer une vision usée de « parti comme bureaucratie du mouvement ».
Pour conclure : nous avons dit qu’il faut traverser le long purgatoire durant lequel le travail révolutionnaire devra nécessairement avoir la forme d’une « politique révolutionnaire » ; à ce stade, « faire une organisation révolutionnaire » veut dire comprendre le niveau du défi et y situer sa propre existence et sa propre initiative de sujet organisé.
Pour qui – comme c’est notre cas – ne considère pas qu’il faille nécessairement tirer des conclusions de spontanéisme radical à partir des enquêtes exposées ci-dessus, les exemples indiqués en disent long sur la nécessité d’organiser le dépassement des formes subjectives actuelles. Il faut penser à organiser des formes provisoires adaptées à la période ; formes dans lesquelles, finalement, la substance du travail révolutionnaire prévaudrait sur ses représentations formelles.
Oreste Scalzone, « Le débat sur l’organisation post-léniniste pour le communisme », in La conjoncture du mouvement et les maux de la subjectivité, « Pre-print », complément au numéro 0 de « Metropoli », 1978.
- Sur le concept d’auto-valorisation, et sa dialectique avec les fonctions organisationnelles « de type parti », voir Antonio Negri, Domination et sabotage, Entremonde, 2019, dont nous avions publié les bonnes feuilles. (NDT)
- Notabene : Une approximation ultérieure d’un concept moderne de parti possible pourrait le définir comme instrument (organe ?) du mouvement général possible. Avec cela on n’entend pas, de manière idéaliste, « le mouvement qui vit dans notre tête », mais ce sujet communiste de masse qui vit, non « à la surface », mais comme tendance matérielle gründlich, comme moteur interne des différents mouvements particuliers manifestes, divers et successifs.
Avec cela nous ne voulons pas introduire un philosophème, faire comme ceux qui prétendent que se révèle seulement à eux la nature intime et dissimulée, le « sens caché » du réel. Ici nulle vertu médiumnique, nul art de sourcier ne sont exigés pour en « venir au fait » : ils parlent d’un « fil rouge » tout à retrouver et découvrir – derrière l’évidence des faits et leur description. Allant, précisément, « au fond des choses », scrutant au-delà des formes phénoménales et conjoncturelles, visant à découvrir les lois du mouvement de cet antagoniste général. De cela, le parti possible auquel nous faisons allusion devrait produire un ensemble de fonctions grand-tactiques. Au regard des épiphénomènes singuliers il devrait avoir, en revanche, un rapport de nette (même si toujours relative) indépendance. - Notabene : en soutenant de manière quasi obsessionnelle l’actualité (ou du moins « l’imminente actualité ») d’un passage au terrain de la « guerre », les formations proto-guérilléristes existantes, les sujets promoteurs du terrorisme diffus pré-guérillériste qui s’est développé ces dernières années ont sauté la phase qui pourrait se définir de « politique armée ». Soit une phase où la guerre commence à vivre à l’intérieur de la politique (ici entendue comme « lutte politique de classe », « politique révolutionnaire ») et où la politique vit comme critère discriminant et orientant, comme intelligence tactique à l’intérieur des éléments de la « guerre » en cours.
Le résultat de ce « saut de phase » a été un balancement entre :
– Un terrain qu’on pourrait définir « de l’idéologie armée » (avec quelques pistes dans le sens de la « propagande armée », rendues cependant relativement modestes et partielles car reprises de manière quasi exclusive par des secteurs de la composition prolétarienne qui – bien que stratégiquement émergents – ont de fortes tendances à l’auto-ghettoïsation, au sous-dimensionnement marginal de soi, à l’auto-identification comme composante extrémiste).
– Quelques « excursions » dans le sens de l’anticipation d’un terrain de guerre. En revanche, ce qui a été défini comme « politique révolutionnaire armée » (soit l’usage – encore en deçà du terrain de la guerre – de la variable militaire à l’intérieur de la générale et complexe lutte émancipatrice du prolétariat, comme attaque à la supériorité grand-tactique et tactique de l’organisation capitaliste qui dérive du monopole étatique de la force armée) n’est quasi jamais entré en scène.
Celle-ci est – certes – vécue de fait. Mais, justement, de manière inconsciente. Il a été certes possible de reconstruire « post festum » les effets politiques du terrorisme diffus, mais ceux-ci ont été en grande partie induits du fait de la quantité, de l’ensemble, du volume général, de l’irrésistible reproductibilité, quasi « naturelle », du terrorisme diffus. Jamais ou presque elle ne s’est exprimée comme contenu prédestiné d’une action, d’une séquence d’actions, d’une campagne, d’une « ligne de combat ».
Ou en tout cas, si cela a eu lieu, ce fut quasi indéchiffrable, non décodable. Non décryptable en somme (nonobstant – mais on revient ici à l’origine du raisonnement – le « discours de la guerre »).
- La critique des organisations de l’aire de l’opposition nous paraît en revanche acquise (des nostalgiques du « Lirico » de la « gauche de la gauche syndicale » aux complices anciens et nouveaux du PCI – « l’esprit » Pdup, le « bras » MLS – à ceux qui balancent entre complaisance du « désir dissolu » dans la « dérive », et sursauts électoralistes et politiciens – réussissant miraculeusement à conjuguer les deux aspects – comme Lotta Continua).