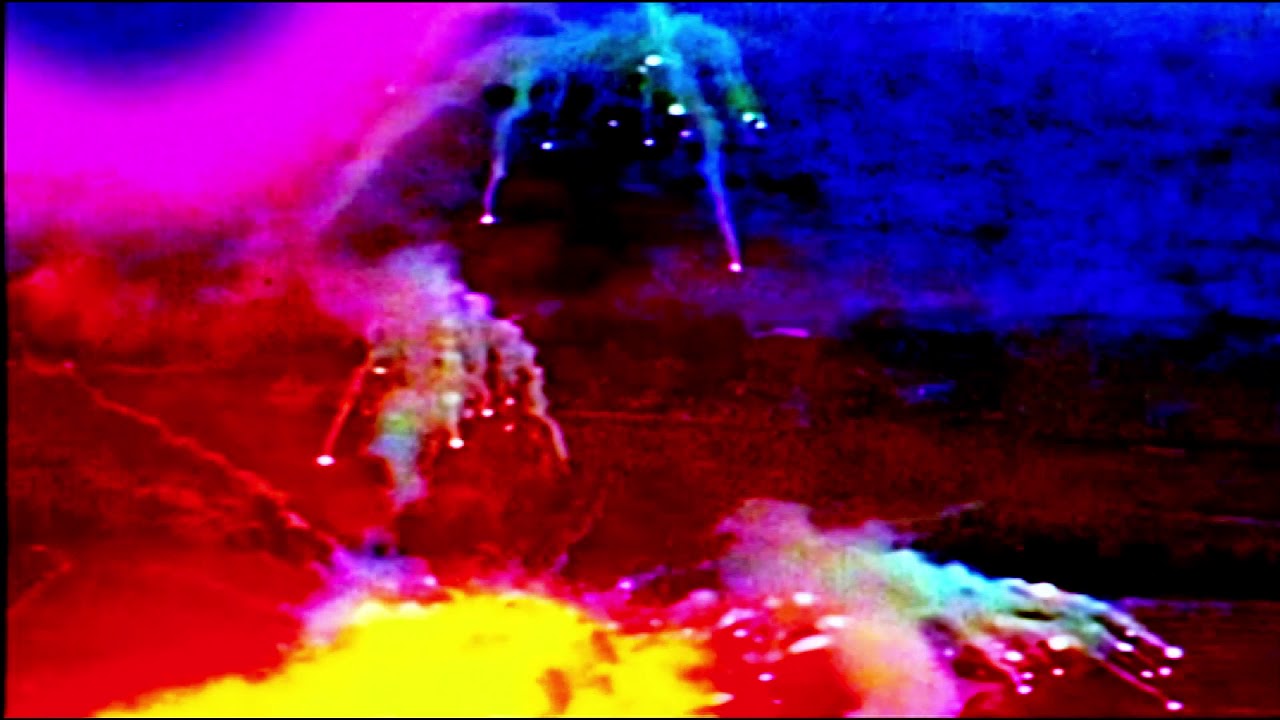
Jean-Luc Godard, Le Livre d'image (2018)
Dans cet entretien, Catherine Hass, anthropologue spécialisée dans l’étude du contemporain, revient pour ACTA sur son ouvrage Aujourd’hui la guerre. Penser la guerre, Clausewitz, Mao, Schmitt, Administration Bush (Fayard, 2019). Fruit de son travail de thèse, l’auteure y mène une vaste enquête sur l’usage du nom de guerre à partir de la guerre en ex-Yougoslavie, au sein de l’espace étatique et, en particulier, de l’administration Bush au cours des années 2001-2003, mais également dans l’espace savant et théorique (sciences politiques, philosophie…) qui, au cours des années 2000, préféra les termes d’« opérations de police » ou d’« état de violence » à celui de guerre pour qualifier les différents théâtres militaires contemporains.
L’approche « en intériorité » qu’elle déploie dans l’ouvrage, dans la lignée de l’anthropologie du nom de Sylvain Lazarus – et dont l’une des thèses est que la politique peut être de l’ordre de la pensée, une pensée singulière qualifiable de l’intérieur de ses énoncés et catégories propres –, permet à Catherine Hass d’établir une constellation de différents « modes politiques de guerre » à partir des écrits de Clausewitz, Mao, Schmitt et ce, jusqu’aux administrations américaines depuis Bush senior, afin de comparer et de mieux comprendre ses usages au présent.
L’interrogation que l’auteure conduit à l’endroit des écarts actuels entre le mot « guerre » et la situation de référence, empirique, qu’autrefois il désignait – absent lorsqu’il devrait être d’usage ou, à l’inverse, martelé là où rien, dans la réalité présente, ne renvoie à une guerre effective –, lui permet notamment de penser l’État contemporain français comme « État-séparé » d’avec ses populations, ou encore les modes de déploiement de l’hégémonie des États-Unis.
La densité de la discussion permet d’entrevoir la richesse des idées développées par l’auteure, dont nous croyons qu’elles permettent une meilleure compréhension des termes dont nous faisons continuellement usage dans notre pratique militante…. Pour peut-être penser une nouvelle donne stratégique.
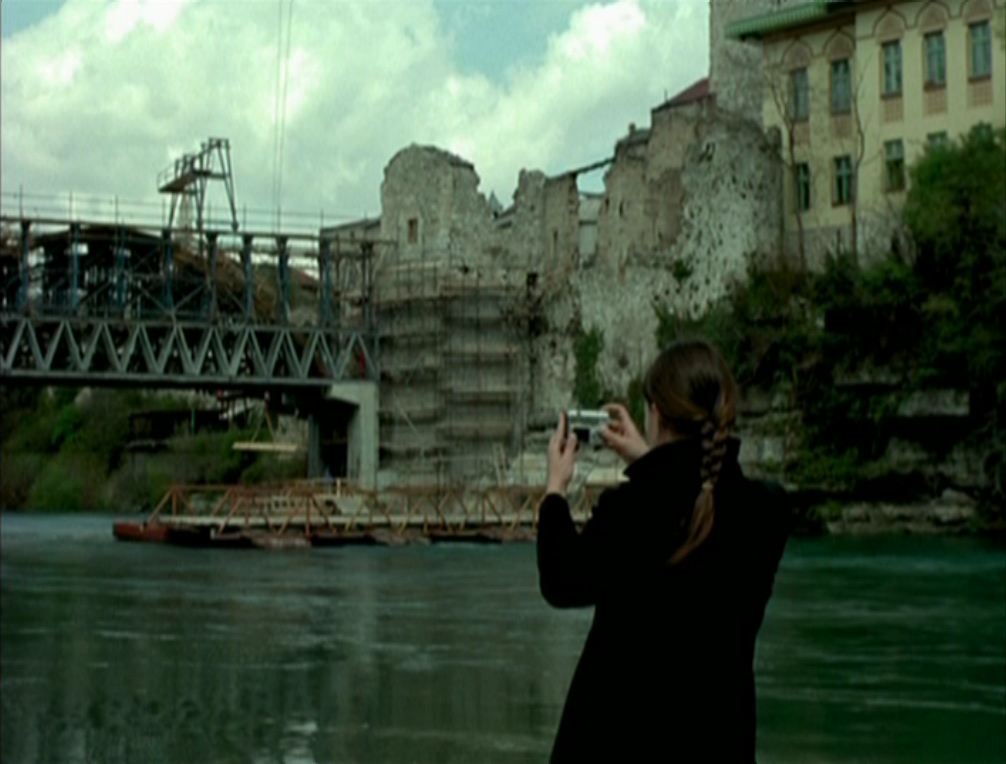
ACTA : Qu’est-ce que la « déshérence du nom de guerre » ? À partir de quand et comment se manifeste-t-elle, à la fois dans l’espace étatique, mais aussi dans l’espace savant et théorique, à travers ce que vous nommez le corpus de la déshérence ?
Catherine Hass : Ce que je nomme la déshérence du nom de guerre, c’est le fait que, au début des années 2000, le nom n’est plus employé pour qualifier les théâtres militaires, qu’il s’agisse des bombardements de l’OTAN sur la Serbie en mars 1999 ou des invasions de l’Afghanistan et de l’Irak en 2001 et 2003. L’on se retrouve alors dans une situation où, si personne ne nie qu’il y ait de la guerre, des guerres, le terme n’est plus, en tant que tel, considéré comme opératoire. La thèse de la déshérence part donc de cet écart, de ce hiatus, entre le mot guerre et la situation de référence, empirique que, jusqu’ici, il permettait de qualifier. Et si l’on fait un bond jusqu’au 13- Novembre, l’on voit que cette période n’est pas close ; le hiatus demeure mais il s’est, en quelques sortes, inversé : il n’y avait pas guerre – pour ce qui est du territoire national – au lendemain du Bataclan, mais le chef de l’État affirme le contraire.
Je date le commencement de cette période aux bombardements de l’OTAN sur l’ex-Yougoslavie car c’est le moment où cette conception se trouve être formulée, explicitée, de part et d’autre. Dans le champ des États, vous avez cette déclaration sans précédent du secrétaire général de l’OTAN qui, juste avant les premiers bombardements sur la Serbie, déclare : « Je tiens à répéter que l’OTAN ne fait pas la guerre contre la Yougoslavie. Il n’y a pas de querelle entre nous et le peuple de Yougoslavie. Nos actions sont dirigées contre la politique répressive de la direction yougoslave. » La déclaration est intéressante car elle énonce, en un sens, les conditions de cette non-guerre, à savoir, la séparation de dimensions solidaires, hier, dans l’espace de la guerre interétatique : les termes État, peuple, politique, « direction » ou gouvernement sont, ici, quasiment autonomisés les uns par rapport aux autres ; et l’Administration Bush, en 2001 et 2003, fera fond sur ces mêmes séparations organisant, en un sens, « le déni de guerre » puisque, désormais, bombarder un pays ne signifie plus nécessairement l’agresser politiquement et donc être en guerre contre lui. C’est ce que nous dit en substance le secrétaire général de l’OTAN.
Du côté de ce que j’appelle l’espace savant, il y a également, à cette période, une entente pour ne plus qualifier les théâtres militaires en termes de guerre ; c’est le moment où des expressions telles celles de « maintien de l’ordre international » ou d’ « opération de police impériale » se diffusent et se donnent comme les termes ad hoc pour qualifier le nouveau de la guerre post-guerre Froide. J’ai alors rassemblé dans le livre les thèses et dispositifs depuis lesquels la fin du nom de guerre se trouvait être argumentée par des auteurs aussi divers que Frédéric Gros, Bertrand Badie ou encore Michaël Hardt et Antonio Negri. Ce qui caractérise alors le « corpus de la déshérence », c’est que la guerre y est tout à fait déspécifiée, sans statut ; elle n’est plus qu’une occurrence structurelle de la mondialisation, une violence consubstantielle de l’ensemble des dérégulations à l’œuvre. Ce à quoi l’on assiste à cette époque, une époque qui selon moi a vécu, c’est à une vaste opération de requalification du lexique admis jusque-là de la guerre, de la politique et de l’État, trois termes alors inséparables ; la globalisation prend, en un sens, le relais de cette configuration puisqu’elle se présente comme le lieu de nouvelles théories générales, contemporaines de l’ère « post-moderne », « post-souveraine » ou encore « post-étatique » qui serait désormais la nôtre. Qu’ils la nomment « états de violence », « violences sociales internationales », « guerre comme ordre permanent » ou encore « militarisation de l’Empire », ce qui va caractériser ce corpus est le fait que le nom de guerre serait devenu sans portée ; le paradigme dominant qui s’y substitue est celui de violence.
On a donc, à ce moment-là, une situation plutôt inattendue en ce que États belligérants et contempteurs résolus des guerres américaines de cette période, partagent la thèse que la guerre serait devenue, en un sens, un vieux mot du vieux monde, actant de la fin des grandes théories et objets du XXe siècle dont la mondialisation aurait sonné le glas.
Quelle conception de l’État ont en commun les auteurs du corpus de la déshérence ?
Ce qu’ils ont en commun, c’est précisément de ne plus en avoir au sens où ils ne considèrent plus l’État comme référent, d’une façon ou d’une autre, dans la pensée de la guerre ; ce qu’ils ont en commun, ce ne sont évidemment pas les thèses, mais ce que j’ai appelé une « problématique de désétatisation » de la guerre ; ils partagent ce socle ou cet arrière-plan, à la manière d’un signe des temps ; or, qu’il s’agisse des États belligérants ou des États attaqués et envahis, la donne étatique empirique n’a évidemment jamais disparu. Le livre d’Alain Joxe, L’Empire du chaos, est à cet égard significatif : les États sont, dans son livre, présents à tous les étages, qu’il s’agisse de sa critique de l’OTAN ou de ses hypothèses géostratégiques à long terme entre la Chine et les États-Unis ; reste qu’ils ne sont pas référents pour penser ce qui a lieu, qu’ils n’ont pas de statut problématique fort. Ainsi, la fin du nom se trouve être contemporaine de la fin de toute prise en compte de l’État dans la guerre dès lors que les partisans de cette désétatisation n’identifient plus les États et leurs politiques comme des occurrences référentielles. Dit autrement, le cadre étatique et ses différents termes – État-nation, souveraineté, unité étatico-territoriale – ne sont plus considérés comme opératoires pour penser la guerre.
C’est à mes yeux un point essentiel car, jusqu’ici, et pour l’ère moderne, l’État était toujours au fondement de la rationalité de la guerre, son architecture spéculative le posant toujours au centre, sous des aspects aussi divers que les rapports interétatiques, la souveraineté, les objectifs politiques, les armées, le monopole de la violence, le pouvoir, le droit international, etc. C’était toujours le mode de présence de l’État, son statut dans la guerre, qui en organisait la rationalité et l’analytique. Il est par conséquent logique que si l’un des termes tombe, l’autre tombe avec lui. L’impossibilité d’identifier la guerre pour elle-même repose bien, dans le corpus de déshérence, sur la fin supposée de son assignation étatique. C’est explicite. La cause en est toujours la mondialisation qui aurait disqualifié puis dissout les formes étatiques, les souverainetés et, par conséquent, mis fin à la politique comme à la capacité des États à la décision.
Je ne conteste évidemment pas la fin d’une certaine figure de l’État et de la politique, ou encore, que la fin de la guerre Froide fût lourde de conséquences, loin de là. Ce que je conteste, c’est que les thèses de la déshérence ne permettent jamais une investigation des formes d’États et de politiques actuelles ; elles postulent leur disparition sans faire l’hypothèse de leur reconfiguration ; elles ne cherchent pas d’autres termes éventuels de la politique et de la guerre mais les postulent finies, inexistantes, comme si le vide théorico-politique laissé par la chute du Mur était irrémédiable. Or, ce point m’apparaissait d’autant plus important que, durant cette période, les États-Unis vont être les grands pourvoyeurs des nouvelles catégorisations de la guerre en procédant justement à sa désétatisation et, de fait, à sa dénomination ; l’expression de « guerre zéro mort » employée au moment des bombardements sur la Serbie portait la négation même de la guerre tandis que celle d’« État voyou » proscrivait la reconnaissance de certains États comme tels. Je fis alors une hypothèse contraire au corpus de la déshérence, à savoir que, loin d’être absent, l’État était l’un des enjeux de ces guerres américaines puisqu’elles me semblaient viser, entre autres, sa transformation qualitative en ne reconnaissant pas certains États comme tels (Afghanistan, Irak), en leur niant, en un sens, leur étaticité. Enfin, autre conséquence majeure à mes yeux : si le nom de guerre ne faisait plus sens, il en était de même pour celui de paix, le terme étant abandonné au profit des expressions de « sécurité », de « retrait des troupes » ou encore de « sortie de guerre ». La fin du nom de guerre, comme dans une chaîne de péremptions, entrainait celui de paix. Cela se vérifiait également dans le corpus de la déshérence où les différentes conceptions structurelles de la violence interdisent, de fait, toute pensée de la paix.

Depuis la chute du mur et en particulier depuis 1995 et la guerre en ex-Yougoslavie, vous analysez les formes de déploiement de l’hégémonie américaine. Quelles sont les conceptions états-uniennes de la guerre à partir de 1995, notamment cette idée grandissante d’une « nation-monde » dont les intérêts nationaux se confondraient avec les intérêts américains où qu’ils se trouvent, sans reconnaissance claire des autres souverainetés étatiques.
Dans le livre, je n’étudie véritablement que la période 2001/2003, soit les débuts de la mise en œuvre de la « guerre contre le terrorisme ». Mais je remonte effectivement un peu avant la chute du Mur pour examiner l’évolution, dans la politique de guerre étasunienne, de quelques catégories, telles celles de guerre, de paix, de nation, d’ennemi, d’État, etc. Je le fais, pour l’essentiel, à partir des National Security Strategy – rapports publiés par la Maison Blanche depuis 1987 à l’intention du Congrès – exposant leur « stratégie nationale » soit leur politique internationale. Ces rapports (dix-sept en trente ans) sont à mes yeux un assez bon observatoire des transformations de leur politique en matière de guerre ; je les mobilise également en vue répondre à la thèse de l’imperium américain soutenant qu’il n’y a jamais rien de bien neuf sous le soleil de l’Empire et ce, depuis le XIXe siècle. L’étude de ces rapports devait m’aider à distinguer les invariants de leur politique nationale internationale des ruptures ou transformations puisque, à mes yeux, les États-Unis faisaient également la guerre avec les catégories politiques de leur temps. Si je réfute la notion d’empire c’est qu’elle désingularise tout à fait la pensée de la guerre, la logique impériale n’étant jamais purement militaire : elle n’est que l’une des composantes d’un hégémonisme plus vaste ; on ne pense pas, et ne saurait penser, la guerre en tant que telle. Ce que l’on observe, c’est que la notion d’empire éclaire toujours l’empire lui-même et ce, depuis une perspective historique voire téléologique devant illustrer les évolutions, les continuités, les dynamiques de l’hégémon ; la guerre n’y est pas une catégorie. Plus avant, la mobilisation du cadre impérialiste a souvent tendance à naturaliser la politique à partir, notamment, de l’économie. Or, tout l’effort de l’anthropologie du nom est une tentative pour la dénaturaliser afin d’essayer de la penser pour elle-même.
Mais pour en revenir aux invariants, vous avez effectivement cette représentation que les États-Unis ont d’eux-mêmes en tant que « nation-monde » ayant un rôle particulier à jouer, flirtant toujours avec l’idée d’une mission civilisatrice telle que la notion de Manifest Destiny l’exprime dès le XIXe siècle, et tel que le corollaire Roosevelt, en 1904, l’institue en fondant leur « pouvoir de police internationale » au nom des « nations civilisées ». En effet, ce pouvoir est exercé dans l’intérêt des États-Unis comme de l’humanité, le corollaire postulant l’identité des intérêts entre eux et le reste de l’humanité. Ainsi, lorsque Madeleine Albright, secrétaire d’État de l’Administration Clinton, emploie l’expression de « nation indispensable » ou que, quelques années plus tôt, Ronald Reagan parle du « du rôle des États-Unis dans les affaires du monde », vous avez la manifestation d’un puissant élément de continuité. Sur cet aspect, l’Administration Trump a opéré une rupture relative puisque son slogan « Make America Great Again » n’était plus tant articulé au reste du monde que centré sur les seuls États-Unis ; il a en un sens européanisé les États-Unis en jouant la partition nationale intérieure.
L’expression de « nation indispensable » n’exprime donc pas tant, selon moi, une idée grandissante qu’un invariant dont l’intensité peut fluctuer ; il me semble également important de ne pas appliquer aux États-Unis une conception proprement européenne de la distinction entre le national et de l’extranational, le national n’étant pas indexé, aux États-Unis, à un État donné dont la souveraineté serait délimitée par ses frontières. La frontière est, historiquement, aux États-Unis, mouvante et désigne les limites de la civilisation donc de la conquête. Si, par opposition, l’on considère l’Europe coloniale, impériale, et tout en laissant de côté l’Empire britannique, typiquement, le Congo est belge et l’Algérie française ; il s’agissait alors de faire entrer dans les frontières nationales les territoires nouvellement conquis en les soumettant à son propre ordre politique.
La rupture entre l’ancien et le nouveau monde telle que formulée, par exemple, dans la doctrine Monroe de 1823 vaut également pour cet aspect : la doctrine énonce l’existence d’un monde, d’un globe divisé en deux hémisphères politiquement dissemblables avec, d’un côté, les continents américains et, de l’autre, « leurs frères de l’autre côté de l’Atlantique », soit les européens. L’hémisphère américain, sans aucune délimitation précise avant 1939, est alors identifié à l’ensemble du continent américain, lui-même soumis « aux droits et intérêts » étasuniens ; cette absence de délimitations spatiales marque une rupture d’avec l’ordre européen où, au contraire, les frontières fondent la souveraineté étatique et nationale : issues des guerres monarchiques, des traités, des États et des nations, les frontières identifient un ordre politique dans lequel les États-Unis ne souhaitent pas se reconnaître. La doctrine Monroe affirme également un principe de politique étrangère valide jusqu’à aujourd’hui que l’expression de U.S. Interests, ou de National Interests, concentre. Cette notion est importante en ce qu’elle permet de déployer la catégorie de nation tout en la déspatialisant : la nation y est conçue comme mobile puisque déliée du territoire ou de l’espace étatique.
Je parle donc, dans le livre, de « nation-monde » en lien avec cette conception de la nation en ce que les États-Unis s’estiment toujours légitimement fondés à faire valoir, n’importe où dans le monde, leur intérêt national ; atteindre cet intérêt, non nécessairement situé sur leur territoire, c’est atteindre les États-Unis et ce, quelle que soit la nature (économique, politique, militaire) ou le lieu de cet intérêt. C’est pour cette raison que je dis qu’un intérêt pour les étasuniens devient un intérêt étasunien ; et cela suffit pour intervenir, comme on l’a vu en Irak en 2003. L’existence de lois américaines extraterritoriales punissant quiconque affecte leurs intérêts est exemplaire de cette conception. Ce fut le cas, on s’en souvient, avec la BNP ou la Société générale qui dut verser, en 2014, neuf milliards de dollars au Trésor américain sous peine de sanctions vertigineuses – la suspension de sa licence bancaire sur le sol américain – pour avoir enfreint les lois Helms-Burton et d’Amato interdisant à quiconque le commerce avec Cuba et l’Iran et ce, au nom de l’embargo américain. C’est également cette loi que les Européens ont voulu contourner après le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018. Mais la crainte des représailles économiques américaines l’a emporté, et des entreprises telles que Peugeot, Total, Sanofi ou Airbus, pour les plus connues d’entre-elles, ont préféré plier bagages.
Les États-Unis disposent donc d’une conception singulière du national, non opposable à l’international mais se confondant avec lui : la politique intérieure inclut la politique extérieure tandis que celle, internationale, est considérée comme nationale. Ce n’est donc sans doute pas un hasard si ce sont les États-Unis qui ont forgé la notion de « guerre contre le terrorisme », l’une de ses caractéristiques étant d’abolir cette distinction. Je dirais que c’est cela la « nation-monde » : se penser comme nation à l’échelle du monde ou dans son rapport à lui et ce, en dehors des limitations étatico-territoriales admises et propres à l’espace européen dans lesquelles les États-Unis ont toujours refusé de se fondre, quand bien même ils y jouent, notamment depuis 1918, un rôle décisif.
Il y a donc sur ce point une spécificité historico-politique de la représentation étatsunienne du monde, constitutive de leur rapport à ce dernier et que la guerre structure pour une large part. Car les États-Unis, ce n’est pas seulement un budget militaire astronomique avoisinant les 830 milliards de dollars – là où les estimations, pour la Chine, sont de 260 milliards -, c’est aussi toute une économie cognitive en ce que la guerre s’y pense sans relâche, le nombre de productions afférentes aux questions de défense y étant sans égal ; on y produit de la doctrine à tous les étages, aussi bien civils que militaires, le nombre d’institutions, d’administrations ou de Think Tanks réfléchissant ces questions étant vertigineux. C’est, je pense, à l’échelle des nations modernes, sans équivalent. Alors si, certes, la Chine fait depuis plusieurs années de la défense une question prioritaire, centrée pour le moment sur une forte militarisation de la mer de Chine, je demeure dubitative quant à la thèse du déclin actuel des États-Unis à l’échelle mondiale en regard, notamment, de la puissance de ses leviers économiques et militaires. Ce qui est certain, c’est que la séquence unipolaire, ouverte avec la fin de la guerre Froide, continue, en un sens, de s’achever.

L’enquête se concentre sur la période qui commence à partir de 2002, mais n’y a-t-il pas une rupture avec le 11 septembre 2001 dans la production idéologique américaine à propos de la guerre ? Pouvez-vous revenir dessus et sur les différences qu’il peut y avoir entre la 1ère guerre en Irak et la 2ème ?
Ma question était : qu’est-ce qui fait que ce qui était tout à fait possible, acceptable, en 2003 ne l’était pas en 1991, à savoir : envahir et occuper un État, pendre son président sur la base du jugement d’un tribunal spécial ? Poser la question des différences entre 1991 et 2003 implique de quitter le temps long de l’histoire et de ses invariants, le temps de la « république impériale » pour citer Aron, afin d’investir le présent politique pour essayer de penser ce qui, précisément, a lieu ; il s’agissait de faire une proposition sur cette différence de traitement de l’Irak entre 1991 et 2003. Mon hypothèse était que l’une des raisons pour laquelle Bush n’alla pas, en 1991, jusqu’à Bagdad, tenait à ce que les termes de la pensée de la guerre n’étaient pas, en 1991, ceux de 2003, au sens où l’ordre international et la reconnaissance des États qui lui est inhérente, étaient encore suffisamment réglés, stabilisés, pour qu’une telle décision ne soit pas possible ou pensable. Mon hypothèse, c’est qu’en 1991, il n’était pas encore envisageable, en dehors de la pure conquête, d’envahir et de détruire un pays sans que celui-ci ne constitue une menace réelle ; il n’y avait pas, disons, d’ennemis sans menace. Je crois qu’en 1991, l’Irak, comme entité étatique, était suffisamment reconnue ; et force est de constater que la guerre, à ce moment-là, suit une conception assez clausewitzienne car l’Administration Bush la conçoit, en 1991, comme un acte de violence « destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté » : quand le Koweït est rétabli dans ses droits et son intégrité, la guerre prend fin. Les différentes productions de l’époque conçoivent la guerre dans une grande clarté antagonique puisque l’ennemi y est identifié à l’État ennemi et la guerre y demeurait de l’ordre du deux. Ainsi, Bush père énonce, avant-même le commencement de la guerre, ses objectifs et, par conséquent, les termes de la paix. Il dit : « Nos objectifs sont clairs. Les forces de Saddam Hussein vont quitter le Koweït. Le gouvernement légitime du Koweït sera rétabli à sa place ». Le terme de la guerre y est clair et correspond à la fin des combats soit à la victoire militaire : « La guerre avec l’Irak est terminée » dit Bush le 6 mars 1991 ; l’embargo qui suit ouvre selon moi une autre séquence. Mais si l’on s’en tient à la séquence de guerre proprement dite, Bush refusa, contre les néoconservateurs qui seront au pouvoir 10 ans plus tard, de renverser Saddam Hussein : le but des États-Unis, et des 35 États constituant la coalition, ne consistait pas, alors, à réformer l’Irak mais à libérer le Koweït. Ce principe vaudra également sous l’Administration Clinton qui, favorable à un changement de gouvernement en Irak, souhaitait néanmoins que celui-ci s’opère par le biais d’un coup d’État et non d’une occupation militaire ; autrement dit, une complète refonte étatique et institutionnelle par la guerre n’était donc pas à l’ordre du jour. Ainsi, l’une des différences entre 1991 et 2003, c’est que la guerre et la mise en œuvre d’un processus de re-conformation étatique étaient distincts.
En 2003, je pense que la souveraineté étatique n’est plus un principe formel partagé de l’ordre international puisqu’elle relève, à l’instar de la guerre, d’une décision et, en l’occurrence, d’une décision strictement étasunienne, les États-Unis, on s’en souvient, entrant seuls en guerre et ce, comme en 2001 lors de l’Afghanistan, en l’absence de toute menace effective à l’endroit de leur territoire. L’un des aspects de la rupture entre 1991 et 2003, ou 2001, c’est notamment que la guerre n’est plus appréhendée comme un conflit entre entités étatico-territoriales mais procède d’une internationalisation des affaires intérieures d’un État où s’affirme la centralité de la notion de « régime ». Deux doctrines militaro-politiques, élaborées par les néoconservateurs au début des années 1990, viennent à l’appui de cette conception : le Regime Change et le Shaping promouvant la re-conformation de certains États par l’ajustement de leurs institutions politiques sur les normes économiques et politiques libérales et ce, par le biais d’une intervention militaire rapide et d’une occupation. Dit autrement, il s’agit de remettre ces États aux normes par l’intermédiaire d’une guerre avant de les resocialiser dans la communauté internationale.
Cette ère qui s’ouvre, dont je parle en termes de « guerres de destruction des États » dès lors que ce sont les formes-mêmes de certains États qui sont visées, se réalise au prix d’un absentement ou d’une disqualification de l’État lui-même ; on en revient à la problématique de « désétatisation » dont je parlais au début. Ainsi, George W. Bush se félicite, en 2003, de l’avènement d’une nouvelle « ère de la guerre » ayant ceci de merveilleux qu’elle est à même de viser un « régime » et non plus une nation : cette opération de séparation fait que l’Irak, comme territoire politique, comme État, n’est plus considéré comme étant agressé ou envahi puisqu’il ne s’agit plus que de changer de gouvernement, de « régime » : la guerre ne relève plus, ici, que du champ de la technicité institutionnelle, gouvernementale et économique puisque c’est la politique intérieure de l’Irak qui est prise pour cible, et non sa politique extérieure.
C’est à partir de ce cadre que les États-Unis, par la voix de George W. Bush, en Afghanistan comme en Irak, se présentent comme des « partenaires » du peuple contre le « régime » personnifié, ici, par son président. Ainsi, en mars/avril 2003, Bush affirme que les États-Unis « n’ont pas d’ambition en Irak » si ce n’est de « supprimer une menace » et de « restaurer le contrôle du pays par le peuple ». Or, si cette intervention militaire n’est pas conçue comme une guerre ou l’agression d’un territoire politique mais comme un « partenariat », le président des États-Unis n’a pas à dissimuler le fait que « les forces militaires resteront en Irak aussi longtemps que nécessaire pour aider le peuple irakien à construire leurs propres institutions politiques et reconstruire leur pays, mais pas plus longtemps. » C’est ce que dit Bush à cette époque. Je n’ai pour ma part trouvé aucune occurrence du terme de guerre dans les productions issues de l’Administration Bush de cette période ; c’est tout à fait cohérent car le terme guerre induirait l’attaque d’un État, une guerre contre l’Irak. À la place, soit ils emploient le terme de conflit, soit ils renvoient à la praxis militaire en tant que telle. Quant à la « guerre contre le terrorisme », elle ne recouvre pas le terme de guerre mais renvoie encore à autre chose.
En n’employant pas le nom de guerre, les États-Unis n’ont pas selon moi tant cherché à masquer une guerre interétatique qui ne dirait pas son nom qu’une guerre de destruction étatique dès lors qu’il ne s’est pas tant agi d’une guerre entre des États que d’une guerre contre eux ; ce point est aujourd’hui, notamment pour l’Irak, tout à fait avéré et personne ne le conteste. Je me souviens à l’époque d’une déclaration du ministre de la Défense de Sarkozy, Hervé Morin, qui, à propos de la présence de troupes françaises en Afghanistan, soutenait que nous n’y conduisions pas de guerre puisque c’était la paix qui y était recherchée. La France épousait alors une conception étasunienne de la paix en ce que, qu’il s’agisse de George W. Bush ou de Obama, celle-ci n’est pas considérée comme un état stabilisé et distinct de la guerre : elle est une sorte de lutte constante, elle se gagne, se défend, et se confond tout à fait avec la guerre. La pax americana y est un bellum americanum que George W. Bush formule en 1999 dans les termes suivants : « La meilleure façon de conserver la paix est de redéfinir la guerre selon nos termes ».
On assiste donc à cette période à un processus de déhistoricisation du nom et à la fondation du hiatus entre le mot guerre et la situation de référence dont je parlais précédemment ; dès lors, c’est tout un ensemble de notions qualifiant hier la guerre qui va voler en éclats : les catégories d’État, d’ami, d’ennemi, de paix, de victoire, etc. vont soit disparaître, soit être complètement redistribuées et refondées. Pour ces raisons, la notion de guerre sans paix qui aujourd’hui fait florès n’identifie pas tant un effet de structure mais se révèle être l’une des conséquences de la guerre telle qu’elle est actuellement conçue et mise en œuvre.
On m’a toujours un peu raillé pour avoir associé les termes « Administration Bush » et « pensée », comme si, entre Clausewitz et Mao, il y avait une réelle erreur de casting. Je mentirais en disant ne pas avoir vraiment douté sur ce point ; reste que, à mes yeux, quelque chose de nouveau se jouait dans l’ordre de la guerre et qu’il fallait tenter de le réfléchir, de l’identifier. Sinon, il ne restait que la thèse de la déshérence, de l’Empire, etc. Si je peux accoler ces deux termes, c’est que la catégorie de penseur n’identifie pas, dans mon travail, une figure noble ou éclairée de la pensée mais l’existence de thèses, de problématisations, de prescriptions politiques sur ce qui est entendu par guerre dans le cadre d’une guerre donnée – c’est la différence avec une approche qui se centrerait sur une seule pensée théorique ou spéculative de la guerre. À ce titre, Hitler et Goebbels peuvent être qualifiés de « penseurs » si l’on s’avère capable de leur attribuer une pensée politique propre de ce qu’ils considèrent devoir être la guerre nazie. Or, force est de constater que durant ces année-là, les États-Unis ont une ambition en termes de redéfinition du concept de guerre et qu’ils y sont parvenus, qu’ils ont produit de la pensée, une pensée telle que nous en sommes toujours captifs ; la guerre selon leurs termes, pour paraphraser George W. Bush, est devenue la guerre selon nos termes. Le paradigme de la « guerre contre le terrorisme » a été, par exemple, adopté de par le monde. C’est peut-être là l’une des plus grandes victoires des États-Unis d’après la guerre Froide : une victoire en forme de monisme politique, celle du monde Un totalement intégré à l’ordre libéral après le monde Deux de la guerre froide ; et cette victoire est fondée, pour part, sur une profonde refonte catégorielle et politique de l’ordre politique mondial.

Dans un contexte d’interventions impérialistes au Moyen-Orient, qui procède souvent par la destruction d’héritages étatiques, tel que le nationalisme arabe, on a l’impression que c’est parce que l’Iran a édifié une nation et un État fort depuis la révolution islamique, que le pays n’a pas plié malgré les pressions extérieures.
Oui je le pense aussi même si l’étiolement ou l’effondrement du nationalisme arabe n’est pas imputable aux seules interventions étrangères mais a également ses causes endogènes ; ne pas considérer ce point, c’est dénier à ces États une capacité politique propre, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Mais la guerre, comme souvent, est aussi, je crois, un immense accélérateur de péremption des formes politiques. Cependant, il ne faut pas oublier que la destruction de l’Irak, en 2003, a succédé à une première guerre puis à un embargo criminel de plus de 10 ans ayant fait, selon les estimations, un million de morts civils ; la corruption s’est généralisée, le pays a été mis à genoux au point que l’armée de Saddam Hussein, en 2003, n’avait pas beaucoup plus à opposer à l’armée américaine que des leurres tels de faux chars en caoutchouc, des avions en bois ou en résine, des missiles factices, des mannequins soldats. Alors si la donne n’est pas aujourd’hui la même avec l’Iran, notamment parce que l’accès aux ressources pétrolifères n’est plus un enjeu depuis que les États-Unis sont devenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole, la situation, en Iran, du fait de l’isolement créé par le renforcement des sanctions américaines, est extrêmement difficile, quand bien même le pays, pour le moment, résiste bien et semble tenir bon.
L’on peut aussi faire l’hypothèse suivante : les États-Unis ne sont pas intervenus en Iran car ils n’avaient pas la capacité d’être militairement présents sur davantage de fronts. Nous pourrions allonger la liste des hypothèses et nous livrer à une théorie des jeux en ce qu’il s’agirait d’étayer chacun des facteurs rendant possibles, ou non, une telle intervention. La logique impérialiste étasunienne n’est pas une boule de cristal à même de nous livrer l’ensemble de ses présages pour l’avenir ! On en revient au débat entre les invariants, le temps long, les spécificités historico-politiques et les ruptures, le présent, la politique : la politique ne se déduit pas toujours de l’histoire, des structures, etc. Ainsi, si l’on peut faire l’hypothèse que les États-Unis continueront d’agir en fonction de leurs intérêts au sens des U.S. Interests, on ne sait pas comment, par quelles voies et moyens ils le feront. Ils pensent aussi avec les catégories politiques de leurs temps quitte, comme je le disais plus haut, à les fonder.
Pouvez-vous revenir sur cette idée qu’à partir de 2002, les conceptions de l’administration Bush consistent à liquider une certaine idée de l’État et de la nation propre au XXème siècle, à travers ce que vous nommez « l’internationalisme libéral états-unien » ?
C’est davantage une hypothèse que j’admets être un peu forcée. Dans le National Security Strategy de 2002, l’Administration Bush énonce sa volonté de clore le XXe en tant que siècle de luttes où se sont opposés deux concepts : la liberté et le totalitarisme. Aucune mention n’est faite dans le document d’un conflit ou d’une guerre en particulier, aucune périodisation n’est énoncée ; il y a juste ce continuum de luttes entre ces deux concepts, de lutte entre des idées. Notez que le terme de lutte n’apparaît dans aucun des NSS entre 1987 et 2001.
En poussant l’interprétation des propos de George W. Bush dans ce NSS, il devient possible de dire que si la « lutte des idées » identifie le XXe siècle, alors ce dernier s’ouvre avec la révolution bolchévique de 1917 puisqu’elle donna lieu à l’édification d’un communisme étatique et, par conséquent, à une altérité politique au modèle libéral étasunien. Or, pour les États-Unis, l’existence d’un multiple des politiques engage, dans ce NSS de 2002, nécessairement une lutte. Pour cette raison, il est possible de dire que la « victoire de la liberté » telle que Bush l’entend, ce serait celle de l’unicité d’un modèle politique. C’est ainsi que l’on peut interpréter ses propos lorsqu’il dit : « Cette grande lutte est finie. La vision militante de classe, de nation et de race qui promettait l’utopie et devait délivrer de la misère a été battue et discréditée. » En extrapolant toujours, l’on peut dire que ce qui serait, ici, achevé, ce serait, en premier lieu, une conception politique de l’État où ce dernier était adossé à l’existence de partis – les États-partis. C’est, me semble-t-il, ce à quoi peut renvoyer la « vision militante », à savoir, l’existence de partis identifiés à une politique ou idéologie, qu’elle soit de classe, de race ou de nation. Communisme, nazisme et nationalisme incarnent ici, sans distinction, trois figures politiques de l’État propres au XXe siècle et aujourd’hui révolues. Si l’on suit cette conception étasunienne, ce n’est donc pas une politique en particulier qui a été « battue » et « discréditée » mais la politique quand elle se donne pour visée l’occupation d’un État par le bais d’un parti qui en propose, de cette façon, une subjectivation. C’est pour cette raison que je dis que la fin de « la grande lutte » dont il serait question ici, pour les États-Unis, ce serait celle de la fin de cette figure-là de l’État ; elle permet alors d’éclairer pourquoi la référence est, dans ce document, tout le XXe siècle, et non une période allant, par exemple, de la fin de guerre Froide à aujourd’hui.
Dans ce NSS, la « lutte des idées » est terminée car ses causes ont cessé : la fin des « idées », d’un pluriel des politiques que l’Union soviétique incarnait au niveau mondial, signe alors la fin de la lutte. La fin de toute altérité politique et de l’existence d’États séparateurs est explicitement donnée par les États-Unis comme leur victoire, une victoire mettant fin aux État- nations concurrents en prise avec des « luttes » politiques. Dès lors, à l’inverse, le XXIe siècle peut être conçu comme un « siècle de paix » en tant qu’il correspond à la victoire du modèle libéral étasunien, le « seul modèle acceptable ». La paix ne signifie donc pas ici l’absence de guerre, mais la victoire du Un politique. Pour cette raison, et bien que rédigé en 2002, soit entre deux guerres dont nous vivons toujours les conséquences, les États-Unis peuvent parler, dans ce NSS, de l’avènement d’une « ère de paix » ou encore de « rivalités » dans la paix. Clore le XXe siècle, ce serait donc le solder en tant que siècle politique clivé entre des États différenciés désormais consommés par l’internationalisme libéral étasunien. Si l’on va au terme de ce raisonnement pour ce qui est de la guerre, les guerres sans politique sont, pour les États-Unis, préférables aux « luttes idéologiques ». Finalement, pour les États-Unis, la question de l’État, de ses figures, traverse assez intensément, d’un point de vue doctrinal et politique, toute cette période.
Par rapport à Trump, vous dites que, contrairement aux idées reçues, l’ère Trump, aussi « nationaliste » ou isolationniste soit-elle, n’en est pas moins belliqueuse et expansionniste que les précédentes. Pourquoi ?
Trump, en maître du désordre assumé, a joué sur tous les fronts de la politique internationale durant quatre ans, de la Corée du Nord à la Russie en passant par l’Iran, Israël ou encore l’Europe. L’expansionnisme n’a pas pris la forme d’une nouvelle intervention militaire – il n’y a rien d’obligé à cela non plus – mais son omniprésence, sa volonté de fragilisation et de déstabilisation, n’a échappé à personne ; de cette façon, il n’a cessé de montrer le rôle cardinal des États-Unis notamment par l’impossible contournement des lois extraterritoriales appliqué à l’Iran. Plus encore, le durcissement des sanctions à leur endroit, le retrait de l’accord sur le nucléaire ou encore l’assassinat du général Soleimani par une frappe de drone, s’inscrivaient dans cette continuité belliqueuse et expansionniste « classique ».
Là où Trump a, me semble-t-il, innové, c’est dans la promotion d’un expansionnisme nationaliste au sens où il s’est massivement positionné sur les nationalismes intérieurs. Le traitement d’Israël fut à cet égard représentatif en ce que, non seulement il n’a pas fait mine de promouvoir la possibilité d’une paix entre Israéliens et Palestiniens mais a ouvertement cherché à aiguiser les antagonismes intérieurs existant (tout comme il l’a fait aux États-Unis), encouragé une politique de guerre à l’intérieur ; il n’est pas intervenu dans la politique israélienne à l’endroit, je ne sais pas, de la Syrie ou de l’Iran, mais a renforcé la politique de conquête intérieure de Netanyahou en vue d’humilier un peu plus les Palestiniens : l’installation de l’ambassade américaine à Jérusalem bénie, on s’en souvient, par des pasteurs évangéliques antisémites proches de Trump, exemplifie ce point. Il s’est fait le chef de file d’une internationale néonationaliste où l’ennemi n’était plus national et extérieur mais intérieur : de Marine le Pen à Bolsonaro en passant par Orban ou Netanyahou, faire feu de tout bois tant que l’on peut éviter la paix ou la concorde civile. Donc, le motif international et guerrier s’est maintenu tout en s’activant autrement, y compris à l’intérieur, comme on l’a vu avec l’invasion du Capitole par des types armés jusqu’aux dents et faisant cinq morts. Reste que la politique nationale et internationale étaient articulées, homogènes. De ce point de vue, on ne peut pas lui reprocher d’avoir manqué de cohérence. Biden promet le retour d’un leadership classique avec, dans le viseur de ses toutes premières déclarations, la Chine et la Russie.
Pouvez-vous revenir sur l’Anthropologie du nom de Sylvain Lazarus et l’usage que vous en faites à propos de ces penseurs de la guerre que sont Clausewitz, Mao et Schmitt ?
Je ne saurais revenir ici sur l’ensemble de l’Anthropologie du nom mais je peux revenir sur l’une de ses thèses, décisive dans mon livre, à savoir que la politique peut être de l’ordre de la pensée, une pensée singulière et irréductible à tout autre, une pensée qualifiable de l’intérieur d’elle-même, soit depuis ses propres thèses et catégories. Cette approche est dite par Lazarus « en intériorité », terme signifiant que l’investigation de la pensée, du subjectif, suspend le recours à tout dispositif de sens extérieur, c’est-à-dire à des concepts, définitions, catégories ou paradigmes préexistants qui la rationaliseraient « de l’extérieur ». La démarche fait au contraire le pari d’une autonomie possible de la politique comme pensée. C’est, à mes yeux, une thèse puissante, créatrice, une thèse de rupture puisqu’elle fait le pari d’une rationalité propre de la politique impliquant de rompre avec les approches de type causal, positiviste, la rationalité scientiste n’épuisant pas, ici, le réel.
La thèse de Lazarus est que, si la politique est de l’ordre de la pensée, elle est nécessairement rare, subjective et séquentielle ; il ne saurait donc y avoir toujours de la politique. Dans le cas contraire, elle aurait le statut d’invariant ou d’une donnée structurelle des sociétés, soit qu’il y ait toujours de la politique, soit qu’elle serait toujours une même chose : et là, on retombe sur ce que je disais, à savoir la convocation d’une définition ou d’un concept de politique « en extériorité ». Pour dire les choses autrement, et de façon très ramassée, il n’y a pas, dans l’anthropologie du nom, de questionnement type : « Qu’est-ce que la politique ? », une question qui, de Aristote à Laclau en passant par Arendt ou Rancière, trouve une multitude de réponses mais, davantage : « Peut-on penser la politique ? »
Chez Lazarus, oui, à condition qu’il y ait de la politique. Le travail de l’anthropologue consistera alors à identifier cette politique depuis ses thèses, prescriptions et énoncés propres, puis à la qualifier, de l’intérieur d’elle-même, selon les termes de la démarche « en intériorité ». Ne pas faire fond sur une définition de la politique est ce qui ici rend possible l’enquête puisque son contenu peut ainsi être entièrement renouvelé à l’aune des différentes pensées politiques éventuelles. Mon exposé est nécessairement incomplet car la politique ainsi conçue est indissociable, chez Lazarus, de son mode comme de ses lieux, deux notions permettant d’appréhender la politique dans son effectivité, dans son historicité propre ; il n’y a pas, ici, « des » politiques mais des « modes politiques » qui cessent lorsque cette politique cesse. Dans le cas contraire, on retombe du côté des invariants, d’une théorie générale ou encore de la politique comme idéologie.
Si la thèse de la politique comme pensée a rendu possible les « modes politiques de guerre », c’est que mon appréhension de la guerre, la rationalité que j’en propose, y est strictement disposée par les thèses politiques de Clausewitz, Mao ou l’Administration Bush, selon ce que chacun problématise sous le nom de guerre ou dispose, par exemple, sous les mots État, paix, révolution, ami, ennemi, nation, politique, lois, parti, contradiction, puissance, liberté ou encore terrorisme. Si l’on admet que la politique ne pense pas la guerre selon les mêmes termes, catégories ou prescriptions, en Prusse en 1806, en Allemagne en 1941 ou dans l’État islamique en 2015, alors comment la pense-t-elle dans chacune de ces séquences ? Telle était ma question et l’anthropologie du nom me permettait d’essayer d’y répondre sans réinscrire les différentes thèses dans le temps long d’une théorie de la guerre, d’une histoire nationale ou d’une géopolitique ; ces dimensions sont indispensables à la connaissance de la guerre en général et sont évidemment présentes dans mon travail, mais elles ne participent pas à sa rationalité telle que nous l’entendons ici : le projet étant celui d’une pensée de la guerre, pour elle-même, à partir de la politique, son but n’était pas de reformuler une théorie générale rénovée de la guerre, de l’ « objet-guerre », mais d’enquêter sur ce qui fut pensé sous ce nom ; pour cette raison, j’emploie le terme de penseur et non de théoricien, même si, par exemple, Clausewitz fut aussi un théoricien.
Cette conception de la guerre centrée sur la politique m’a permis, je crois, d’ouvrir un champ de connaissance de la guerre autre mais aussi de répondre au corpus de la déshérence en ce que, dans ce dernier, l’État est toujours au centre de la guerre : c’est toujours son mode de présence, son statut dans la guerre, qu’il soit présent ou absent, qui en organise la rationalité ; c’est son marqueur premier. L’approche en termes de « modes politiques de guerre » me permit donc de rompre avec cette approche stato-centrée de la guerre.
Vous analysez chez trois auteurs, des modes politiques de la guerre. La guerre comme moyen de création nationale chez Clausewitz, la guerre comme condition de la révolution chez Mao, la guerre comme restauration d’une communauté politique souveraine chez Schmitt. Chez ces trois auteurs, l’idée d’État est mise à distance pour bâtir une pensée de la guerre pour elle-même, à partir de la politique, en fonction d’un contexte et d’une politique spécifiques.
C’est effectivement l’un des résultats de l’enquête : le constat d’une mise à distance de l’État dans leurs conceptions politiques de la guerre, comme si la pensée de la politique nécessitait cette opération de séparation d’avec l’État en ce que l’un ne saurait être assimilable à l’autre ; cela ne signifie pas que l’État ne soit pas très important mais il est soit mis à distance, soit différé. Il faut préciser, autre résultat de l’enquête, que Schmitt ne relève pas, dans le livre, d’un mode politique de guerre mais d’un mode politique que je qualifie d’antagonique dès lors qu’il ne pense pas tant la guerre que la politique et ce, même s’il assigne cette dernière à la guerre. Mais même chez lui, dans La notion de politique, la politique, pour être pensée, doit être distinguée de l’État.
Chez Mao, la catégorie centrale, c’est celle de parti et l’État n’y est jamais vraiment une catégorie ; il se situe, à cet égard, durant la guerre, à l’opposé de Lénine qui, à la veille d’Octobre 1917, affirme : « Nous avons besoin d’un État ». Cela tient selon moi au fait que Mao, durant la guerre, ne pense jamais la politique en dehors des situations ; pour cette raison, si la question de l’État n’est pas à l’ordre du jour de la situation, il ne la pose pas. Ce point est perceptible dans le texte De la démocratie nouvelle datant de 1940 où Mao répond à ceux qui, dans le parti, estiment la puissance des communistes telle que le temps de l’État serait venu. Et si Mao répond, il diffère la question, nous sommes en 1940, période où les communistes se rallient effectivement « toutes les classes de la société chinoise », et Mao ne souhaite pas s’aliéner ni la petite bourgeoisie ni les intellectuels ; or, l’édification d’un État communiste aurait forcément été clivant. Mao parle alors d’un « État nouveau » qui ne serait ni une dictature bourgeoise, ni une dictature révolutionnaire, mais une dictature « exercée en commun par toutes les classes révolutionnaires » ; ce « en commun » fait également écho, chez Mao, à la question nationale qui a toujours été, chez lui, centrale. Cependant, quand la question de l’État s’impose parce qu’elle devient effective, soit à partir de 1945 dans le cadre d’un possible gouvernement de coalition entre les communistes et les nationalistes, Mao la traite.
Chez Clausewitz, l’État est également présent – la thèse exacte de Clausewitz est d’ailleurs « la guerre est la continuation de la politique d’État par d’autres moyens » – mais ce n’est pas depuis sa sphère que ses thèses politiques sur la guerre sont formulées ; ce qui, pour lui, prime, c’est la nécessité d’avoir une politique et un État peut très bien ne pas en avoir, à l’instar de la Prusse de 1806 face aux troupes de Bonaparte ; que la politique doive se réaliser dans l’État n’indique pas que l’une se confonde avec l’autre : pour grossir le trait, nous pourrions dire que s’il y a toujours de l’État, il n’y a pas toujours de la politique – même si vous avez des administrations, des ministres, des décisions, etc. Notes sur la Prusse dans sa grande catastrophe de 1806 est, en un sens, consacré à cette question. Dans ce texte, la politique, pour Clausewitz, doit être une capacité subjective identifiée, en l’occurrence, à une subjectivation nationale.
Enfin, dans La notion de politique, Schmitt entend également se constituer une doctrine propre de la politique distincte de l’État. La communauté politique (allemande) telle qu’il la définit est une unité politique pouvant se substituer à l’État puisqu’il considère ce dernier, en 1919, soit au lendemain du Traité de Versailles et de la création de la Société des nations, comme étant à son déclin. Pour Schmitt, et dans cet écrit-là, la politique précède l’État, raison pour laquelle c’est elle qui doit être prioritairement réfléchie. Cela ne signifie pas que la politique ne doive pas, idéalement, se réaliser dans l’État, un État fort, décisionniste ; Schmitt est un juriste constitutionnaliste et un étatiste impénitent.
Quoi qu’il en soit, chez chacun de ces auteurs, il y a cette opération de séparation consistant à dissocier la politique de la philosophie, du droit ou encore de l’État, une opération nécessaire pour la penser en propre, même si évidemment, ce n’est pas dit en ces termes.

À propos de l’État français contemporain, qu’entendez-vous par « monopole de l’État par lui-même » ou « sur-étatisation » ?
Je ne suis pas certaine que le terme soit très bon mais je n’en ai pas trouvé d’autres. Cette expression entend désigner le fait que l’État serait aujourd’hui le seul à produire de la politique ; pas uniquement en termes de décision, mais en termes d’énoncés, de catégories, de prescriptions : il serait le seul, en ce sens, à avoir une prise sur lui-même, d’où ce terme de monopole. C’est contemporain de ce que j’appelle l’État séparé ou l’État sans possible au sens où il n’y aurait pas d’autres politiques possibles que celle énoncée par l’État ; séparé au sens où il me semble qu’il n’existe plus de modalité d’inclusion ou de forme d’écoute possible du peuple, des gens, dans l’État. L’État séparé, ce serait une sorte d’État endogène ne considérant rien de ce qui n’est pas lui ou n’émane pas de lui ; ce serait ça l’hyper-étatisme de l’État, son monopole sur lui- même.
Le terme de séparé m’est venu une première fois en 2006 à l’occasion de la loi pour l’égalité des chances visant alors les jeunes issus des dites zones urbaines sensibles, c’est-à-dire des quartiers. Je me questionnais sur l’étrangeté consistant à faire entrer, dans une loi, la catégorie de chance, sur l’opportunité de la codifier puisque les droits ouverts par la loi reposaient sur la décision de l’État à dire qui avait de la chance ou pas et non sur, disons, un traitement générique des situations. Cette date ne correspond pas à l’amorce d’une transformation de l’État mais la présidence de Sarkozy, réformateur certain, l’a selon moi consolidé.
La réforme du baccalauréat initiée il y a deux ans en est, parmi bien d’autres, un bon exemple. La réforme est très lourde, introduit des changements considérables pour les enseignants et les élèves mais le ministère ne se pose jamais la question de sa praticabilité et n’inclut jamais, sous une forme ou une autre, les enseignants devant la mettre en œuvre, leurs propositions n’étant jamais jugées comme recevables. Les syndicats, considérés comme vecteur de conservatisme, ont été totalement évincés du processus d’élaboration de la loi comme de son application puisque tout se joue désormais entre le ministère et les rectorats. La répression des élèves comme des enseignants contestataires est alors immédiate et vigoureuse, le moindre blocus donnant lieu à l’envoi illico de la police. Et ce qui vaut pour l’école et l’enseignement vaut pour l’hôpital, les transports, les retraites, la culture, etc. Il semble que les marges existant, hier, autour, disons, des conflits sociaux, aient disparu. À Mantes la Jolie, en 2018, c’est l’opposition à la réforme du bac qui se solde par la séance d’humiliation collective filmée par un agent de police ; ailleurs, c’est quasiment toute une classe de lycéens placée en garde à vue pour les mêmes motifs.
Cette absence de toute forme d’écoute semble donc revendiquée et se traduire par un usage sans délai de la violence. Aujourd’hui, si une question portée par une mobilisation, quelle qu’elle soit – loi travail, Gilets Jaunes, université, école, « migrants », police, COVID – ne trouve pas sa résolution dans les termes tels qu’énoncés par l’État, il semblerait que ce soit matraque, LBD ou dissolution. Et souvent, lorsqu’une directive n’est pas, dans une administration (écoles, hôpitaux), suivie à la lettre, rappels à l’ordre et menaces de sanctions sont immédiats, supprimant de fait toute marge ou possibilité d’appropriation des consignes par les gens eux-mêmes comme on le voit depuis le début de la crise sanitaire. À l’inverse, les manifestations dont les demandes sont portées par l’État, telles que le climat ou les violences faites aux femmes sont, elles, pacifiques ; et encore, ça dépend : souvenez-vous des images de ces manifestants assis d’Extinction rébellion sur le pont de Sully gazés en plein visage, ou encore, des manifestations lors de la COP 21 en 2015. Ce n’est évidemment pas en soi nouveau qu’une manifestation soit réprimée et, sur le temps long, elles le sont sans doute moins durement qu’avant ; mais pour la période récente, il semblerait que, depuis la loi travail de 2016, quelque chose ait changé avec le sentiment que, désormais, ce sont les manifestations dans leur ensemble qui sont constituées en cible.
J’ai récemment lu la loi dite Kouchner de 2002 portant sur les droits des malades ; bien que je n’y connaisse pas grand-chose en santé publique, ça se lit d’emblée que c’est une « bonne loi » ; je parle de « bonne loi » car il est explicite qu’il s’agit de donner plus de droits à la personne malade, de la mettre au centre de sa maladie et, ainsi, de rééquilibrer la relation de pouvoir entre les patients et les professionnels de santé ; et bien ce n’est sans doute pas un hasard si cette loi a été l’objet d’une concertation dont l’ampleur a été inédite : qu’il s’agisse de la consultation des associations de patients, de la tenue d’états généraux de la santé, ou de la rédaction de cahiers de doléances à l’échelle du pays. Cette loi n’a pas été élaborée de façon, disons, endogène ou séparée mais en instituant des formes d’écoute, d’inclusion. Telle est sans doute l’une des conditions pour qu’une loi soit une « bonne loi » car, sans cela, il n’y a pas de mode de présence du réel, des situations réelles, disons, vécues par les gens, dans l’État. Et si Macron ne cesse d’organiser, depuis les Gilets Jaunes, des consultations populaires, ça ne dépasse pas, à ce jour, une mise en scène assez populiste du pouvoir lui-même par l’intermédiaire de son chef ; ce ne sont pas tant des dispositifs d’écoute que de justification du pouvoir.
Cet État dit séparé se consolide selon moi lors de la présidence de Sarkozy. Je peux me tromper mais je crois que depuis la mobilisation étudiante et lycéenne en 2006 contre le CPE, soit sous Jacques Chirac, aucune mobilisation de masse n’a réussi à se faire entendre sur les grandes réformes, à être victorieuse. On l’a peut-être oublié mais, sous Sarkozy, les mobilisations d’ampleur n’ont pas cessé, qu’il s’agisse de la réforme de l’hôpital, de l’université avec la loi sur l’autonomie, des retraites ou encore des lycées. Face à ces grèves et manifestations, Sarkozy disait publiquement des choses comme : « Quand il y a une grève, personne ne s’en aperçoit » ou encore : « J’écoute les inquiétudes mais je n’en tiens pas compte » ; vous me direz que c’est normal, classique, que c’est son rôle et que Juppé ne disait pas autre chose lors des grèves de 1995 ; mais il ne me semble pas que c’était énoncé à la façon d’un principe de gouvernement par le président de la République, disqualifiant d’emblée syndicats et manifestants.
En 2007, alors que j’étais très engagée pour la régularisation des ouvriers sans papiers, on a nettement senti cette clôture dans l’État, le fait que plus aucune forme d’adresse à son endroit n’avait de portée : ce n’était plus comme ça que ça fonctionnait ; cela ne signifiait pas que l’État ne régularisait pas mais l’hypothèse d’une régularisation disons un peu massive ou selon des critères autres que les siens, était devenue tout à fait exclue ; en cela, le sarkozysme lamina nombre d’associations ou d’organisations politiques disons extra-parlementaires ou aux marges du parlementarisme, qu’il s’agisse du logement, des papiers, etc. ; et pas uniquement celles ayant l’habitude d’être en négociation d’une façon ou d’une autre avec l’État et qui n’ont plus dès lors trouvé d’interlocuteurs puisqu’il n’y avait plus rien à négocier. C’est, de fait, également le moment où les syndicats ont été de plus en plus latéralisés par l’État. Cela s’est également ressenti lors des manifestations par la présence de la police qui, quasiment du jour au lendemain, triplait ses effectifs d’encadrement.
S’il est aujourd’hui tout à fait banal de parler de la fin des partis, des corps intermédiaires, on lit me semble-t-il un peu moins de choses sur ce que cette fin a transformé dans l’État et dans son rapport aux gens. Or, selon moi, on ne peut pas, par exemple, appréhender aujourd’hui le déploiement violent de la police contre les grandes mobilisations de ces dernières années sans les articuler à cette transformation de l’État. Ce n’est sans doute pas le tout de la question de la police et de la crise qu’elle traverse, mais si on ne l’articule pas davantage à cette transformation, on a tendance à autonomiser la question dite des violences là où, à mes yeux, elle n’en a pas. Or, l’usage actuel de la police – quelle que soit l’occasion, on envoie a minima 10 000 policiers –, l’importance politique grandissante qu’elle recouvre, me semble indissociable de la façon dont l’État se redispose comme séparé et institue ce qui semble être un rapport renouvelé entre lui, la police et les gens. Je ne pense pas, c’est une hypothèse, que l’on peut avoir le même type d’État dit séparé avec une importance moindre de la police et du sécuritaire ; il n’y a pas un « bon État », une sorte d’« État nounours » derrière le « mauvais État » qui serait le nôtre et qu’il faudrait débarrasser de ses scories sécuritaires et policières : il y a l’État tel qu’il est aujourd’hui, comme ensemble.
En se concentrant sur la dénonciation de la violence de la police, même si c’est évidemment à juste titre, j’ai l’impression que l’on contracte la question au lieu de la déplier pour davantage la politiser dans ses usages actuels, qu’il s’agisse de l’ensemble de la loi relative à la sécurité globale, du livre blanc de la sécurité intérieure mais aussi le traitement sécuritaire de questions relevant du champ social, éducatif ou sanitaire. Je trouve à cet égard très intéressantes les propositions de dissolution de la BAC que l’on peut lire dans les manifestations parce qu’elles ouvrent tout un champ de questions : Qu’est-ce qui justifie la constitution de telle ou telle police ? Pourquoi telle population et tel territoire doivent-ils être l’objet d’une police ad hoc ? Qu’est-ce qui distingue telle police dans ses missions ou ses compétences de telle autre ? Je les trouve intéressantes car elles donnent une prise, concrète, sur la question de la police en permettant de la réfléchir, de la déplier et donc, éventuellement, de faire des propositions à son endroit. Et ça, ça peut se conduire, par exemple, à l’échelle des quartiers et des gens eux-mêmes. C’est une sorte de chemin de traverse en regard du vaste face-à-face disons idéologique dénonçant « l’État policier » ; c’est, en un sens, le contraire du mot d’ordre « Tout le monde déteste la police ».
La place politique nouvelle qu’occupe aujourd’hui la police est aussi un héritage du sarkozysme ; je pense notamment au discours de Grenoble de 2010 où il affirma, à l’occasion de la nomination d’un ancien policier au poste de préfet : « Quand on est policier, on a le sens de l’État ». Or, un policier est tenu d’avoir le sens du délit, du crime ou de l’ordre public et non de l’État, tout comme un professeur a, disons, le sens de l’instruction et un médecin le sens du soin. Un policier n’a pas à avoir le sens de l’État, à moins d’indexer le sens de l’État sur l’ordre policier. Et c’est quand même un peu à quoi on assiste aujourd’hui, non pas au sens d’une police politique mais davantage de quelque chose comme une politique de la police. C’est pour ça que la problématique des violences me semble indissociable de l’ensemble du spectre sécuritaire grandissant à l’aune duquel des questions qui, hier, avaient, disons, leur propre champ de résolution politique, sont aujourd’hui traitées et soldées. Si l’on considère la question des mineurs isolés ou la gestion de la crise sanitaire, aucune des deux ne relève a priori des registres policiers et guerriers à partir desquels elles sont aujourd’hui traitées : la première relève strictement, en regard des lois françaises, de la protection de l’enfance, la seconde, de la santé publique. Et les exemples sont multiples : de l’amendement finalement censuré en vue de sanctionner l’occupation des universités par une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende à la policiarisation du domaine de la fête de Nantes à Lieuron. Cela vaut évidemment, et depuis longtemps, pour les quartiers populaires où le paradigme sécuritaire va finir par totaliser l’ensemble du traitement proposé par l’État, au détriment, par exemple, d’une réflexion sur le retrait des associations, le manque d’éducateurs, l’absence de formation professionnelle pour les jeunes ayant quitté l’école, la suppression des contrats aidés, etc. À cet égard, on peut dire que l’État fait d’abord des lois pour lui-même et a renoncé à une politique publique dont l’adossement seraient les questions ouvertes ou posées par les situations réelles affectant aujourd’hui la vie des gens.
Tout ça pointe peut-être aussi un défi pour les mobilisations et luttes actuelles en ce qu’il ne s’agirait pas tant d’éviter la violence mais de trouver les voies pour ne pas être systématiquement ramené à la question de la police, à sortir de la nasse politique du sécuritaire tout en le traitant. Comment faire pour que le solde d’une manifestation ne se réduise pas au décompte des devantures brisées ou, aujourd’hui, celui des mains arrachées et des yeux perdus ? Les manifestations contre la loi travail ont vu affluer, en nombre, des gens de la France entière ; je me souviens avoir marché auprès de dockers du Havre. Quel bilan de la manifestation ? La façade brisée de l’hôpital Necker et son canon à eau. Il m’a semblé que des mobilisations de Gilets Jaunes, dans la diversité de leurs interventions, ont parfois cherché à n’être ni ramenés ni réduits à la question de la police ou de la violence.
Je me suis éloignée de la question mais cet « hyper-étatisme » c’était aussi une forme de réponse au corpus de la déshérence postulant la fin du caractère politique de l’État. Or, si j’affirmais le contraire, il fallait bien que j’en propose quelques termes.

Le nom de guerre est toujours d’usage dans notre société, il peut même être martelé avec force, mais pas forcément à bon escient. Par exemple, en quoi la séquence ouverte en 2015 avec les attentats de Paris est-elle déterminante pour l’écriture de votre ouvrage ?
Ce livre est, pour l’essentiel, issu de ma thèse et son projet précède donc de beaucoup la séquence ouverte en 2015. Son titre était : Une enquête anthropologique sur le nom de guerre : Clausewitz, Mao, Schmitt, Administration Bush ; autant dire que, avant le 13-Novembre, il était tout à fait cryptique à part pour trois personnes. L’intitulé est devenu limpide après, la question du nom de guerre se posant, après le Bataclan, à chacun. La séquence ouverte en 2015 n’a donc rien déterminé, si ce n’est des mises à jour prenant en compte ce qui s’était passé en France. Si ma thèse s’est trouvée être ajustée à la séquence, c’est, je pense, parce que nous étions toujours, pour ce qui est de l’usage du nom de guerre, dans la séquence ouverte en 2001 ; les déclarations de Hollande après le Bataclan sont, mot pour mot, identiques à celles de Bush en septembre 2001. Il n’y a donc pas, pour moi, un usage à bon ou à mauvais escient du mot : s’il est évident que ce n’était pas la guerre, l’usage désormais quasi-routinisé du mot pour la politique intérieure doit être interrogé comme tel. Et, de fait, dire la guerre quand il n’y a pas la guerre, c’est toujours dire, pour un État, son intention de la faire et disposer un antagonisme. Cet usage est homogène à la « guerre contre le terrorisme » dès lors qu’elle rend tout à fait poreuses les séparations constituantes de la guerre interétatique depuis, disons, le XVIIIe siècle, entre politique intérieure et extérieure, entre policier, civil et militaire, entre guerre et crime, guerre et terrorisme, paix et sécurité, ami et ennemi.
Il n’y a donc pas un usage impropre du mot mais un usage propre au régime de la « guerre contre le terrorisme » dont la caractéristique est de ne pas être strictement indexée au champ militaire et valide pour la politique intérieure, un usage que je ne sais pas encore qualifier avec exactitude. Et, de fait, les décisions consécutives à la déclaration de guerre de Hollande relevaient, pour l’essentiel, de la politique intérieure, la France étant déjà engagée dans la coalition internationale bombardant alors la Syrie. Pour le reste, qu’il s’agisse de l’état d’urgence, de la déchéance de nationalité ou des contrôles aux frontières, les décisions relevèrent de la politique intérieure ; le fait que, précisément, nous étions déjà en guerre, en Syrie, au Mali, n’a jamais été articulé au « Nous sommes en guerre » de l’intérieur. Donc pour moi, le point, nouveau, c’est le fait que la politique intérieure relève si aisément du registre de la guerre.
Guerre contre le virus, de nouveau guerre contre le terrorisme suite à l’attentat de Conflans, séparatisme, le « quand on veut la guerre, on l’assume » adressé aux gilets jaunes… quelques mots sur l’usage du nom de guerre dans ce contexte de gestion de l’urgence sanitaire, de répression et d’expansion de l’islamophobie ?
Si l’on en revient à l’État séparé, l’on peut se demander si la guerre ne serait pas son mode de gouvernement. Dit ainsi, c’est énorme, mais c’est l’État lui-même qui mobilise ce lexique. Reste que si l’on dit que l’État séparé, c’est l’État sans possible, alors la guerre est sa figure privilégiée au sens où c’est elle qui dit le mieux l’absence d’alternative : quand c’est la guerre, c’est la guerre, et il n’y a pas d’autres possibles politiques, si ce n’est la désertion ou le pacifisme. Car le lexique de la guerre n’offre aucun choix : on ne moufte pas et l’on doit se ranger derrière lui au risque, finalement, de passer du côté de l’ennemi puisque rien, outre cette mise en antagonisme de la politique, ne demeure. À l’inverse, affirmer que nous sommes en paix, c’est refuser que son champ ne totalise tout, qu’il rétrécisse la pensée de ce qui a lieu.
Le choix de la guerre est destructeur car il disqualifie toute autre forme de pensée, d’approche, de termes, de politiques, qui ne s’y inscriraient pas. Il étatise également de façon très autoritaire la politique, et l’aisance avec laquelle il est aujourd’hui mobilisé atteste de la crise d’un État qui n’a plus la capacité de mobiliser les termes d’une crise autrement qu’à partir de ce mot. Car placer, par exemple, la santé publique sous l’égide de la guerre, c’est tout simplement l’abandonner en ne la considérant plus pour elle-même dès lors qu’elle est subordonnée à la guerre. Or, qu’est-ce qui, dans la crise sanitaire, ne relevait pas strictement du soin, de la santé, de la recherche publique, de la prophylaxie mais du registre de la guerre ? Absolument rien. Et cela vaut, selon moi, pour tout autre domaine politique.
Le registre de la guerre, c’est également celui de la brutalité politique que la crise sanitaire a documenté chaque jour. C’est à mes yeux une pente catastrophique pour la politique en tant que telle mais aussi parce qu’elle induit une sorte de familiarisation, d’acceptation morale de cette brutalité. Dans Considérations actuelles sur la guerre et la mort écrit en 1915, Freud dit que l’une des causes du processus de dé-civilisation à l’œuvre dans la guerre réside dans la corruption morale de l’État dès lors qu’il promeut, en temps de guerre, tout ce qui, en temps de paix, lui est proscrit (injustice, violence, rupture des traités, soif de puissance, etc.). Cette corruption importe à Freud notamment pour ses effets subjectifs dans le peuple, ce qu’il appelle « la moralité des particuliers » : « Quand la communauté supprime le blâme, cesse également la répression des appétits mauvais, et les hommes commettent des actes de cruauté, de perfidie, de trahison et de brutalité dont la possibilité eût été tenue pour inconciliable avec leur niveau de culture. » Alors, certes, nous ne sommes pas, et heureusement, en 1915, mais je crois que placer la politique intérieure sous la paradigme de la guerre peut avoir cet effet subjectif et corrupteur dès lors que l’État demande aux citoyens de consentir à cette brutalité ; et, on l’a vu aux États-Unis ou au Brésil avec les électeurs de Trump ou de Bolsonaro, les peuples sont parfois tout à fait disposés voire impatients d’y consentir.
Affirmer que nous sommes en paix, c’est également, d’une certaine façon maintenir l’éventualité d’autres possibles en ne basculant pas toute la politique dans la guerre : sinon, vous la détruisez et il n’y a plus qu’un seul possible : celui édicté par l’État. Son corolaire, ou son exigence propre, est le dessaisissement de la politique par tous ceux qui ne sont pas lui. Et la crise sanitaire a documenté ce point depuis un an. Il est sur cet aspect intéressant de noter que l’un des succès du gouvernement a été, je crois, les opérations de dépistage coordonnées par l’ensemble des pharmacies au mois de décembre. Je parle de réussite car il semblerait que, grâce à cela, l’on ait évité la flambée épidémique annoncée d’après les fêtes de fin d’année et que les taux de contaminations demeurent stables : les gens se font tester. Or, si c’est une réussite, c’est peut-être parce que l’ensemble des pharmacies, en France, y ont été associées, mises dans la boucle ; ça et la gratuité car un test de dépistage peut coûter, par exemple, au Royaume Uni, jusqu’à 500 euros ou 150 francs en Suisse. Qu’il s’agisse des pharmacies ou des administrations, quand elles sont parties prenantes de la mise en œuvre des politiques publiques – quand il y en a une – et qu’elles ont les moyens de travailler, notamment à l’échelon local, et bien elles fonctionnent plutôt très bien. Mais le constat est celui d’une défiance terrible à leur endroit de la part du gouvernement, l’État séparé ayant des effets dans l’État lui-même pour ce qui est de son rapport aux administrations.
La mobilisation du registre martial peut-être interprété ici comme la fuite en avant sécuritaire d’un État ayant abandonné toute politique de santé ou de recherche publique ambitieuse. Car, on le sait, la létalité du virus est directement corrélée aux politiques de santé publique soit à la capacité d’hospitalisation, de soin, de dépistage, de prévention. Ainsi, au Brésil comme au Liban, les gens meurent d’abord de ne pas avoir d’oxygène en quantité suffisante. Peut-être qu’aux États-Unis, ils meurent d’abord de l’absence de couverture de santé. En Europe, c’est de vivre dans une maison de retraite, hors-champs du spectre hospitaliser, qui tue massivement depuis le début.
Les grèves dans les hôpitaux juste avant la pandémie n’ont cessé de dire que le personnel médical ne pouvait plus soigner convenablement les patients tant ils étaient déjà à l’os en termes de lits, de personnel, de moyens ; leurs propositions, doublées d’un mouvement significatif de démission de chefs de service, n’ont évidemment pas été entendues. Si le développement des soins en ambulatoire est, en général, la réponse de l’État pour justifier la fermeture des lits à l’hôpital (entre 2003 et 2017, le nombre de lits a baissé de 69 000, une baisse entraînant avec elle celle du personnel soignant), un certain nombre de médecins ont alerté, depuis longtemps, sur les risques de cette politique en regard, notamment, du vieillissement de la population, les personnes âgées nécessitant des hospitalisations plus longues. Il est donc logique que ceux qui payèrent le prix de fort de cette pénurie structurelle furent les personnes âgées vivant en EHPAD, le trop faible nombre de lits rendant matériellement impossible, dans l’ensemble, leur prise en charge hospitalière ; elles sont donc, pour la plupart d’entre elles, restées sur place ; et ceux qui n’étaient pas contaminés le sont devenus très vite dès lors que le virus se mettait à circuler et qu’il n’était pas possible d’isoler les personnes. À cet égard, selon moi, certains EHPAD ont été transformé en léproseries modernes et ont été le lieu d’agonies insoutenables du fait, notamment, d’un dénuement médical parfois complet. En France, le nombre de personnes décédées en EHPAD a représenté quasiment 30% du total. Mais c’est logique lorsque vous lisiez que certains hôpitaux étaient arrivés à saturation de leurs capacités en réanimation… avec parfois 16 lits occupés, c’est-à-dire très peu. Et à ce jour, les décisions en termes de confinement continuent d’être directement corrélées aux capacités hospitalières. Le Grenelle de la santé organisé cet été n’a absolument pas infléchi cette politique et des lits continuent d’être fermés. Ce choix s’est donc avéré, d’une certaine façon, criminel, mais d’une criminalité toute libérale c’est-à-dire indirecte, impersonnelle.
De façon symptomatique, outre le fait que l’essentiel de cette crise soit placé sous le sceau du secret défense et géré, pendant un temps, depuis le bunker antiatomique de l’Élysée à 70 mètres sous terre – on peut difficilement faire plus séparé ! –, l’exécutif n’a pas hésité à mesurer le succès du confinement au nombre de contrôles effectués : durant le premier confinement, cent mille agents des forces de l’ordre ont contrôlé plus de 20 % de la population pour 1,1 million de contraventions. Je trouve ces chiffres vertigineux. Si on imagine un instant une politique de santé publique de crise dotée d’instances réglées sur cette seule question, peut-être qu’une bonne partie de ces agents de police aurait pu être assignée à d’autres tâches : aider à transporter vers les hôtels obstinément déserts des personnes vivant en EHPAD ; appliquer du virucide dans les lieux et établissements publics, qu’il s’agisse des écoles ou des transports en commun ; installer des aérateurs dans les universités ; renforcer les « brigades de contact tracing » dont les effectifs ont longtemps été notoirement insuffisants, etc. On peut aussi imaginer, pour les EHPAD, la généralisation de détachements exceptionnels de personnel médical ou paramédical, comme l’ont parfois fait les ARS, une campagne massive de dépistages, l’envoi prioritaire de masques, une coordination quelconque de ces établissements à l’échelle nationale. L’État n’a pas même cherché à compenser le fait que, si on ne pouvait pas hospitaliser les personnes, l’on pouvait au moins chercher à réduire la mortalité. Ainsi, la réquisition des stocks de masques décidée par l’État au début du confinement a eu des effets absolument terribles dans les EHPAD.
Cela me semble aller de pair avec le fait qu’il m’a toujours semblé que, dans sa réponse aux Gilets Jaunes, Macron disait, en substance : cessez de croire que l’État est là pour les gens, dans leur intérêt ou pour leur protection, qu’il s’agisse de la santé, des retraites, du chômage, du travail, du logement ou des aides diverses. L’État social, foncièrement, ce n’est pas la modernité, ça appartient au passé et c’est un conservatisme que de vouloir le maintenir : il n’a pas à compenser, par son intervention, les inégalités existantes. Macron, c’est Thatcher contre « les gaulois réfractaires » pour ce qui est de sa volonté d’attaquer et de défaire ce qui relève, en France, d’un État pour tous à la fois protecteur et redistributeur. Sauf que, cet État social fait, par exemple, que le taux de pauvreté, en France, demeure l’un des plus bas d’Europe (même si en hausse), bien moindre qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni. Mais la seule protection qu’il nous faudrait accepter, c’est ici celle de la police.
Pour ce qui est de la dissolution du CCIF, celle-ci s’est faite dans un quasi consensus assourdissant : déclarée du jour au lendemain « ennemie de la République » par le ministre de l’Intérieur, l’association a été dissoute sans aucune autre forme de procès, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Le mot « islamophobie » a été durablement criminalisé si bien que celui qui le prononce se présente aujourd’hui comme possiblement coupable de « séparatisme » donc, grosso modo, comme potentiel ennemi de l’intérieur. Tout comme il n’y avait pas, durant les Gilets-Jaunes, pour Macron, de violences policières, il n’y aurait pas d’actes islamophobes en France. Et ce sont ceux qui, précisément, portaient ces actes devant les tribunaux, qui se trouvent être sanctionnés et désignés comme coupables. Bien sûr, les personnes ont toujours la possibilité de porter plainte pour de tels actes mais dans un cadre ne permettant pas de politiser ou de publiciser cette question, c’est-à-dire dans un cadre strictement juridique. Ainsi, au lieu d’ouvrir le champ de sa propre critique pour faire en sorte que, effectivement, des actes de cette nature n’aient plus lieu, d’ouvrir le chantier politique sur ces questions de discriminations parfois très bien documentées, l’État postule leur inexistence et criminalise un débat politique.
On peut tenter ici une hypothèse en rapprochant le traitement, par l’État, des Gilets Jaunes et la dissolution du CCIF. En effet, si l’on est d’accord pour dire que la mobilisation du registre guerrier étatise de façon très autoritaire la politique en suspendant tout autre forme de possible, d’alternative, et que seuls les termes énoncés par l’État se trouvent être valides ou acceptables, il est logique qu’il s’oppose à la politisation d’une question n’émanant pas de lui mais des gens, groupes, mouvements, associations. Si, aujourd’hui, on politise une question en lien avec l’islam, on « islamise » et, grosso modo, on « terrorise » voire on « gangrène » à court ou moyen terme. Je rapproche cet exemple des Gilets Jaunes car le mouvement, notamment au début, prenait en charge et politisait des questions qui, d’ordinaire, relèvent du seul champ technocratique : je pense ici à la question fiscale, très présente. En effet, le propos général n’était pas de dire « On paye trop d’impôt » mais de politiser cette question, en la documentant et en la socialisant, afin de politiser celle de la redistribution et des services publics.
La mobilisation du paradigme guerrier cherche toujours à ouvrir de nouveaux paradigmes politiques. Si vous considérez la question de la dissolution des associations, de la fermeture des mosquées, ou hier, celle de la déchéance de nationalité, vous observez que, d’une manière générale, les lois existent déjà : l’article 25 du code civil autorise la déchéance de nationalité pour acte de terrorisme ou atteinte aux intérêts de la nation, tout comme les appels à la haine, au meurtre, les propos racistes et xénophobes, ou encore, le fait de menacer quiconque de mort, tout cela est déjà pénalisable en regard du droit commun existant. Vous pouvez ajouter à cela, dans le cadre de la politique antiterroriste, l’existence de dispositifs de surveillance et de renseignements supposés être efficaces, ce qui est loin d’être toujours le cas. Bien sûr, vous pouvez augmenter et modifier les lois, mais c’est un mensonge de dire que les arsenaux législatifs n’existent pas déjà. Pour cette raison, l’enjeu est d’abord l’énoncé d’un paradigme politique nouveau. Qu’il s’agisse de la santé, de l’islam ou, demain, allez savoir, des quartiers populaires en cas d’émeutes, il me semble qu’il n’y a pas, en politique intérieure, d’usage à bon ou à mauvais escient du mot de guerre mais un usage fatalement dangereux, délétère et possiblement criminel à combattre par celui de paix : affirmer que nous sommes en paix me paraît être aujourd’hui une thèse forte car elle nous permet précisément d’ouvrir un tout autre paradigme politique que celui proposé par la guerre. Or, à la guerre, les ennemis, on les tue.
