
Nous avons réalisé cet entretien avec Jérôme Baschet à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Une Juste colère. Interrompre la destruction du monde, aux Éditions Divergences. Ce livre – qui contient à la fois un retour sur le mouvement des Gilets Jaunes (en particulier la centralité de la pratique du blocage, le refus de la représentation et l’invention de nouvelles formes d’auto-organisation populaire), des analyses sur les derniers développements d’un capitalisme néolibéral qui accélère toujours davantage le désastre écologique, ainsi que d’intéressantes propositions quant au renouvellement de la stratégie révolutionnaire – nous paraissait un excellent support pour aborder avec son auteur les problématiques les plus urgentes de la situation.
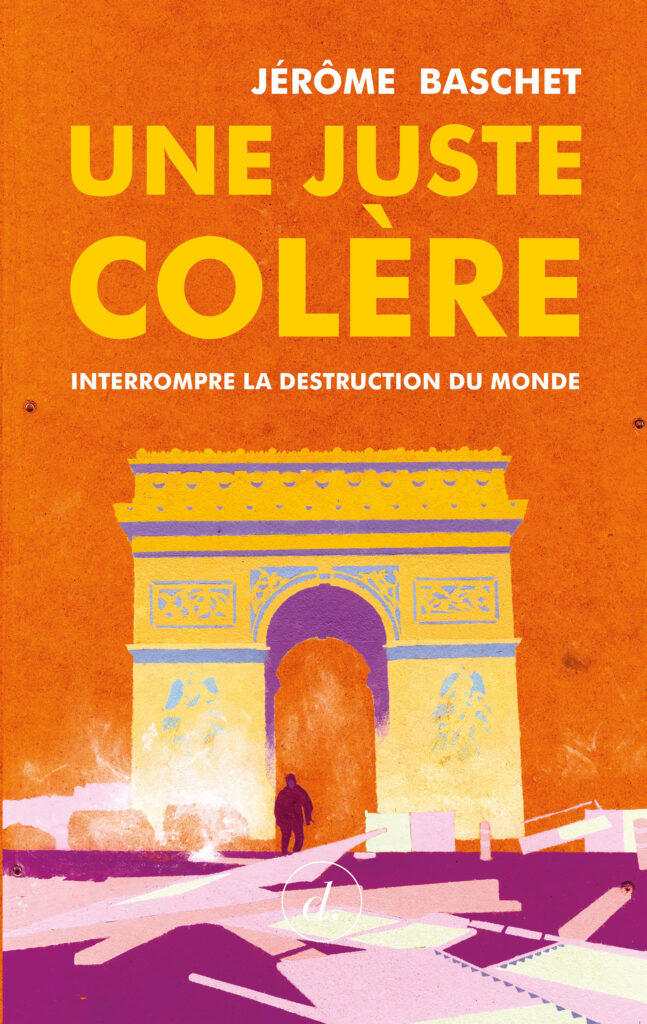
1. J’aimerais te poser une première question sur le titre même de ton livre, ou plutôt le sous-titre : « interrompre la destruction du monde ». Depuis le 19ème siècle et pendant longtemps la tradition du mouvement communiste a pensé que la révolution était, comme disait Marx, une « locomotive de l’histoire », que l’émancipation humaine était en quelque sorte inscrite dans le développement historique lui-même. Walter Benjamin a renversé la formule, suggérant que la révolution serait plutôt « l’acte par lequel l’humanité qui voyage dans le train tire les freins d’urgence ». Tu sembles donc t’inscrire davantage dans cette filiation. Quels sont pour toi les enjeux d’un tel changement de paradigme ? Et en quoi sont-ils liés en particulier à l’actualité du désastre écologique ?
Jérôme Baschet : J’admets bien volontiers cette lecture benjaminienne du sous-titre. Un mot d’abord sur le mot « destruction ». Il me semble caractéristique d’un troisième âge de la critique du capitalisme. Le premier était centré sur l’exploitation, le second sur l’aliénation et le troisième sur la destruction. Il a pu être anticipé par certains, mais cette dimension devient désormais clairement dominante, tant c’est la dévastation écologique – au sens large des trois écologies de Guattari – qui vient au premier plan. Ce qui ne veut pas dire que les autres dimensions de la critique – et les autres aspects de la domination capitaliste qu’elles pointaient – soient invalidées ; simplement, elles doivent être reformulées dans un nouveau contexte où la barbarie capitaliste atteint un tel degré que c’est la possibilité même de la vie sur Terre qui est, potentiellement, remise en cause.
« Interrompre la destruction du monde », donc ; mais j’aurais aussi bien pu dire, même si la formulation peut paraître étrange, « Interrompre le monde de la destruction ». Car c’est bien de ce monde de la destruction, qui écrase et anéantit tant de mondes multiples, qu’il s’agit d’interrompre le cours. Interrompre la destruction du monde, en somme, ne peut signifier rien d’autre que mettre fin au monde de la destruction. Et ce monde, c’est le monde de l’Économie – un monde dominé par la tyrannie économique et animé par une compulsion productiviste qui est la source directe de la présente dévastation écologique et humaine.
Cela implique en effet un « changement de paradigme » quant à la conception de la révolution et, plus largement aussi, du temps historique. On a pu dire récemment qu’il existait un clivage majeur au sein des pensées de l’émancipation. Pour les uns, il faut préserver, ou retrouver, les paramètres classiques de la modernité, et en particulier une conception de l’Histoire entendue comme avancée triomphale du Progrès. Il paraît certes de plus en plus difficile de soutenir une telle image ; mais certains n’hésitent pas, face à l’obstacle, à forcer le trait en défendant des thèses « accélérationnistes » selon lesquelles, pour sortir du capitalisme, il faut non seulement continuer à aller « dans le sens de l’histoire », mais, qui plus est, y aller le plus vite possible en intensifiant les caractéristiques technologiques et organisationnelles les plus avancées du capitalisme ! En avant toute, camarades ! De l’autre côté de la ligne de clivage, on trouve tous ceux qui, à la suite de Benjamin, considèrent qu’il faut abandonner entièrement une intenable conception moderne-progressiste de l’Histoire. Aux arguments que Benjamin faisait valoir en 1940 s’en sont ajoutés d’autres ; et, aujourd’hui, c’est la destruction écologique qui transforme de manière visible et dramatiquement sensible la marche glorieuse du Progrès en course folle vers l’abîme.
Tout cela a des conséquences considérables sur la manière de concevoir un possible processus révolutionnaire mais aussi, plus largement, les relations entre présent et futur, ou entre passé et futur. Nous n’avons plus l’Histoire avec nous ; nous ne sommes plus les messagers d’un quelconque sens de l’Histoire qui nous entraînerait inexorablement vers le salut. Il y a là tout un ensemble de représentations qui ont été hautement efficaces et mobilisatrices, même s’il est aisé aujourd’hui d’en reconnaître le caractère factice et illusoire. Mais cela veut dire aussi qu’une autre conception de l’histoire, de l’agir collectif et de la manière d’entrelacer au présent la mémoire vive de passés réminiscents et l’anticipation de futurs possibles est à inventer entièrement.
2. Venons-en au mouvement des Gilets Jaunes, autour duquel tourne ton livre. Tu insistes sur un élément essentiel qui le caractérise, à savoir le refus de la représentation, le refus de toute « récupération politicienne » et de toute normalisation dans les formes classiques de la politique. En effet il est frappant de constater que là où la plupart des mouvements de masse de la dernière séquence ont donné lieu à l’émergence de partis parlementaires ayant la prétention d’en incarner le « débouché politique » (Podemos en Espagne, Syriza en Grèce), n’aboutissant qu’à des formes de social-démocratie renouvelée, celui des Gilets Jaunes semble pour l’instant déroger à la règle. Comment l’expliquer ? Quelle est la raison de ce refus aussi enraciné de la représentation politique, du jeu parlementaire traditionnel ?
Jérôme Baschet : On peut dire que le soulèvement des Gilets Jaunes a fait exploser les cadres de la politique classique, celle qui est fondée sur le principe de la représentation, et qui a pour centre les partis et la compétition électorale pour le contrôle de l’appareil d’État. Bien sûr, il y a eu des tendances inverses : des tentatives de s’ériger en porte-parole du mouvement ou en négociateurs auto-proclamés avec le gouvernement ; des essais, de la part de militants d’extrême-droite ou de gauche, pour infiltrer et orienter le mouvement. Mais le plus impressionnant est l’intelligence collective qui a été déployée par les groupes de Gilets Jaunes, le plus souvent avec succès, pour détecter et empêcher la main-mise des militants politiques ou syndicaux. Au point que les profils plus militants qui ont été acceptés au sein des Gilets Jaunes n’ont pu s’y intégrer, en règle générale, qu’à la condition d’abandonner leurs discours et leurs attitudes habituelles, pour se mettre à l’école d’une dynamique collective rompant avec les paramètres de la politique classique.
On ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais il est peu probable, en effet, que des partis-mouvements comme Podemos s’affirment en France comme « débouché politique » du soulèvement des Gilets Jaunes. En revanche, la préparation des élections municipales de 2020 pourrait être l’occasion d’un rebond de certaines préoccupations exprimées par les Gilets Jaunes. S’il s’agissait alors de rentrer dans le jeu politique classique, par exemple en intégrant des figures estampillées « gilets jaunes » dans les listes des partis ou de personnalités déjà en place, cela n’aurait pas plus de sens que les listes anecdotiques qui ont vu le jour à l’occasion des européennes. Conquérir des mairies en prétendant ensuite développer des formes de démocratie participative présenterait également d’évidentes limites et ne modifierait que superficiellement les cadres de la politique classique. En revanche, le moment des municipales pourrait être un prétexte pour relancer la formation d’assemblées populaires, au niveau des quartiers ou des communes, qui seraient à même de prendre en charge l’organisation de certains aspects de la vie collective. Dans le cas où elles en auraient la force, elles pourraient tenter de s’emparer des communes pour étendre leur capacité d’action, tout en transformant les élus municipaux en simples exécutants des décisions des assemblées. Un tel processus n’a rien d’aisé et n’est pas sans risque. Mais on ne doit pas exclure a priori que l’ancrage local du mouvement des Gilets Jaunes et les réseaux de solidarité concrète qu’il a fait émerger puissent trouver à se consolider et à s’étendre en profitant de l’espace ouvert localement par l’échéance municipale. Bien que cela puisse paraître paradoxal, cela ne signifierait pas nécessairement un retour aux formes classiques de la politique. À condition que l’enjeu et l’attention ne soient pas centrés sur les conseils municipaux, mais bien sur les assemblées populaires, qui pourraient alors faire émerger de véritables contre-pouvoirs.

3. Une question qui prolonge la précédente. Les Gilets Jaunes ne se sont pas contentés de critiquer la démocratie représentative mais ont expérimenté la mise en œuvre de nouvelles formes d’organisation collective, « par en bas », à travers en particulier la multiplication des « assemblées populaires ». Celles-ci préfigurent selon toi des instances d’auto-gouvernement et font écho à d’autres aventures de la politique d’émancipation, passées (la Commune de Paris) comme présentes (le Chiapas et le Rojava notamment). Qu’est-ce qui relie ces différentes expériences et en quoi le mouvement des Gilets Jaunes peut-il s’inspirer de ces autres séquences révolutionnaires ?
Jérôme Baschet : Il est en effet important de souligner la dimension positive du soulèvement des Gilets Jaunes. S’ils ont récusé radicalement la politique classique – c’est-à-dire la politique d’en haut, centrée sur le pouvoir d’État, les partis, la classe politique et les « experts » de la chose publique –, ils ont cherché à expérimenter une autre politique, qui part d’en bas, des lieux de vie concrets et de la capacité des personnes ordinaires à s’organiser et à décider par elles-mêmes. C’est le refus de la politique d’en haut et le choix de cette politique d’en bas qui crée une affinité profonde entre le soulèvement des Gilets Jaunes et les autres expériences que tu mentionnes, la Commune de Paris, le Rojava, le Chiapas ou d’autres encore. Et, bien sûr, cette coïncidence me paraît hautement significative.
Toutefois, je ne dirais peut-être pas exactement que les assemblées qui ont émergé dans le cadre du mouvement des Gilets Jaunes préfigurent des instances d’auto-gouvernement. Ce n’est là qu’un devenir possible, notamment si l’on prend en compte l’Appel de Commercy à former partout des assemblées populaires grâce auxquelles « reprendre le pouvoir sur nos vies ». Mais il serait exagéré de laisser entendre que les assemblées des Gilets Jaunes tendaient nécessairement vers des formes d’auto-gouvernement, que celles-ci en étaient l’horizon naturel. Quant à la Commune de Paris, au Rojava et au Chiapas, ces références sont apparues sporadiquement, et il est heureux qu’elles n’aient jamais été invoquées comme des modèles – ce qu’elles ne sauraient être.
Ceci dit, si l’on veut donner à la politique d’en bas toute sa force et la pousser jusqu’au point où elle serait capable de destituer la politique d’en haut, alors en effet il convient – peut-être dans le cadre d’un mouvement de blocage généralisé ? – de faire émerger des instances d’auto-gouvernement populaire. Autrement dit, des instances d’auto-organisation de la vie communale. Et, en cette matière, il faut bien reconnaître que la Commune de Paris ou l’autonomie zapatiste sont des expériences particulièrement inspirantes. L’appel de certains courants des Gilets Jaunes à multiplier les assemblées populaires pourrait être une manière – nécessairement singulière – d’esquisser de telles pratiques d’auto-gouvernement populaire.

4. Un autre aspect fondamental du mouvement des Gilets Jaunes concerne la centralité du blocage comme mode d’action. Aujourd’hui, alors que le capitalisme a étendu sa domination au-delà de la sphère productive et tend à englober tous les aspects de l’existence, la grève seule apparaît comme insuffisante à soutenir un véritable rapport de force. D’où la nécessité, que tu pointes, d’une « articulation de luttes multiples », d’une coordination de subjectivités sociales différentes, toutes en prise avec une même logique de « dépossession généralisée ». Entre autres exemples, le blocage du marché de Rungis a vu se cristalliser une alliance pratique entre gilets jaunes et bases syndicales combatives. De même certaines organisations de quartiers populaires comme le Comité Adama ont très tôt appelé à rejoindre les Gilets Jaunes et affirmé leur solidarité avec le mouvement. Quel regard portes-tu sur ces tentatives de croisement et en quoi la suite dépend-elle d’un renforcement possible de ces ébauches d’alliances ?
Jérôme Baschet : De tels croisements me semblent en effet importants, et parvenir à leur donner plus de force serait certainement décisif. Un chapitre du livre est consacré à la question du blocage, parce qu’il a constitué l’une des dimensions majeures des formes d’action des Gilets Jaunes. À partir de là, j’essaie de souligner qu’il pourrait être pertinent de prendre cette notion de blocage dans toutes ses dimensions possibles, en pensant que celles-ci peuvent se combiner, plutôt qu’en cherchant à les opposer. Cela inclut le blocage des flux et des infrastructures, c’est-à-dire de la sphère de la circulation (des personnes, des marchandises et des flux d’informations). Mais aussi le blocage de la consommation (les Gilets Jaunes, en plus des axes de communication, ont très souvent visé les centres de la grande distribution). Le blocage de l’aménagement économicisé des territoires (là, ce sont les luttes territoriales, contre les grands projets nuisibles et inutiles). Le blocage de la reproduction sociale (les grèves de la jeunesse pour le climat remettent en question la reproduction sociale, dont l’école est l’un des vecteurs). Mais aussi le blocage de la production elle-même, à travers la grève.
Sur ce dernier point, il est clair que la grève a perdu la centralité qui a été la sienne durant toute l’histoire du mouvement ouvrier. D’abord parce que les réorganisations du monde du travail à l’âge néolibéral ont tout fait pour la rendre de moins en moins possible et de moins en moins efficace. Mais aussi parce que le monde du travail ne peut plus être considéré comme la seule sphère – ni même la sphère par excellence – où s’exercent les rapports de domination constitutifs du capitalisme. Cette domination déborde le cadre du travail et, dès lors qu’il s’agit aussi de produire des citoyens dociles et des consommateurs avides, elle pénètre le temps « libre » des loisirs et de la consommation, s’insinue dans tous les aspects de la vie et modèle de plus en plus directement des subjectivités entraînées à la compétition, au culte de la réussite et à l’évaluation quantitative de toute chose. À l’âge classique du capitalisme, il pouvait paraître que l’opposition Capital/Travail en condensait l’antagonisme fondamental – et encore, c’était prendre le risque, hautement problématique, d’oublier autant la domination de genre que la domination coloniale, pourtant l’une et l’autre essentielles pour l’affirmation du capitalisme. À l’âge du capitalisme néolibéral, sans que la question du travail ni celle de la grève ne doivent disparaître entièrement de nos radars, les antagonismes fondamentaux du monde de l’Économie doivent être repensés de manière plus ample, pour englober les multiples modalités d’une dynamique de dépossession généralisée : dépossession du sens de son travail, accentuée par les contraintes insatiables de la maximisation ; condamnation à l’inexistence sociale à travers le chômage, la précarisation et l’exclusion ; spoliation des territoires par la multiplication des grands projets et l’avancée du front de marchandisation ; impossibilité de vivre en sécurité pour les femmes exposées à la violence de genre ; infériorisation et discrimination vécues par les populations racisées ; jouissance souvent frelatée du consumérisme se retournant en asservissement aux contraintes de l’endettement ; sentiment de dépossession politique de plus en plus largement ressenti face à la décomposition des démocraties représentatives ; dépossession de notre temps sous l’effet de la tyrannie de l’urgence ; sans oublier le plus grave : la destruction écologique en cours qui nous dépossède de la possibilité d’une vie digne. Il y a donc, d’un côté de l’antagonisme, tout ce qui contribue à cette dépossession généralisée, elle-même associée à la destruction pure et simple ; et de l’autre tout ce qui cherche à s’y opposer, en un sursaut éthique pour sauver la possibilité d’une vie digne pour tous les habitants humains et non humains de la Terre.
C’est cette compréhension ample des formes multiples de la dépossession induite par le monde de l’Économie qui peut donner sens à une stratégie fondée sur l’amplification du blocage, entendu sous toutes ses formes. « Bloquons tout » paraît une manière pertinente de s’opposer aux dynamiques de la domination capitaliste et à son extension à l’ensemble des dimensions de la vie. Enfin, il faut souligner que le blocage sous toutes ses formes répond très concrètement à l’urgence écologique : n’est-ce pas le moyen le plus direct d’interrompre la destruction du monde, en « coupant le robinet » des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les autres pollutions responsables de l’effondrement du vivant ?

5. Évoquant les « actes » insurrectionnels de novembre/décembre, tu affirmes que l’on s’est trouvé « à deux doigts d’une situation dans laquelle le pouvoir pouvait perdre la main ». Que pour la première fois depuis longtemps en France, la destitution du pouvoir est apparue comme une perspective « crédible »…dans le fond, qu’a-t-il manqué pour rendre ce renversement effectif ? Et quelles leçons tirer pour l’avenir de ce moment critique ?
Jérôme Baschet : Dans les premiers jours de décembre, les dominants ont eu peur face à un soulèvement populaire, ce qui, en France, n’était pas arrivé depuis longtemps. Un déploiement maximal des forces de l’ordre s’est trouvé sur le point d’être dépassé et les hommes du pouvoir ont admis à demi-mot que le quinquennat macronien était en jeu. Et cela, alors même que l’appel à la destitution du chef de l’État paraissait encore, quelques jours plus tôt, de l’ordre du vœu pieu. Bref, le pouvoir a vacillé.
Bien sûr, on peut se demander ce qu’un départ de Macron aurait pu changer. Il y a loin de la destitution d’un président à celle du pouvoir d’État. Et c’est sans doute une limite liée au fait de se donner comme ennemi principal un homme politique en particulier. Il est vrai que la haine que Macron a concentrée sur sa personne a été un carburant utile pour le soulèvement, mais il faut certainement donner raison aux Gilets Jaunes qui pensaient qu’un autre ne ferait pas mieux et, plus encore, à celui d’entre eux qui a fait remarquer qu’une fois Macron parti, il ne faudrait surtout pas le remplacer.
Ce qui a manqué pour grignoter ces « deux doigts » qui ont finalement empêché la situation de basculer entièrement ? Certains ont dit : l’entrée en lice des principales centrales syndicales ; mais pouvait-on en attendre autre chose qu’une distance méfiante à l’égard d’un mouvement qui signait le déclin des formes de mobilisations qu’elles incarnent ? Le basculement massif vers la grève des bases syndicales combatives, comme cela a pu être le cas ponctuellement et tardivement, aurait certainement été important. Une ample jonction avec les luttes des quartiers, qui n’a fait que s’esquisser, aurait certainement changé la donne. C’est, pour une large part, une fraction des classes populaires qui s’est soulevée – ancrée dans les zones périurbaines, installée dans le salariat, souvent propriétaire et blanche. Le soulèvement des Gilets Jaunes n’a impliqué que très peu l’autre fraction des classes populaires, vivant dans les quartiers, racisée, plus souvent précaire et victime de l’exclusion. Tout est fait pour que ces deux fractions des classes populaires restent divisées, voire hostiles l’une à l’autre, affrontées par des racismes qu’alimente notamment l’extrême-droite. De ce point de vue, le fait que le mouvement des Gilets Jaunes ait pu faire reculer, pour beaucoup de ceux qui en ont vécu l’expérience, l’emprise du racisme et de l’extrême-droite et, très concrètement aussi, la méfiance envers les populations « issues de l’immigration » ou envers les migrants est un signe encourageant dans la perspective d’un rapprochement possible. L’implication de certaines organisations de lutte des quartiers en est un autre. Mais on est loin encore des conditions qui permettraient de réunir vraiment les deux moitiés des milieux populaires, par-delà tout ce qui tend à les diviser. Enfin, il a sans doute manqué à l’appel certains bataillons plus « militants », qui se sont tenus à l’écart d’un mouvement qui suscitait leur méfiance, en raison de la présence de l’extrême-droite en son sein, mais sans doute plus encore parce qu’il leur paraissait trop « impur », trop éloigné des formes de mobilisation que leur appartenance militante les avaient habitués à tenir pour légitime.
Quoi qu’il en soit de ce qui a manqué, il reste un acquis fort. Il tient à la révélation de la puissance qu’un surgissement populaire, soudain et imprévu, sans appui logistique d’aucun appareil préalablement constitué, est capable d’acquérir. Une nouvelle perception, amplement partagée, de ce qu’il est possible de faire, a émergé. Et il ne faut pas minimiser l’effet que cette expérience acquise collectivement et cette perception partagée des possibles pourront avoir lors de soulèvements ultérieurs.

6. Sur un plan plus stratégique, tu reprends certaines intuitions déjà contenues dans l’un de tes précédents livres, Adieux au capitalisme (La Découverte, 2014). On partage l’idée qu’aujourd’hui la prise du pouvoir d’État ne peut plus constituer un objectif régulateur de la politique d’émancipation et que le communisme doit être envisagé moins comme un horizon à atteindre que comme un processus qui se construit au présent. Les bases matérielles d’un tel processus sont ce que tu appelles les « espaces libérés », soit des formes immédiates d’expérimentation d’une réalité post-capitaliste au sein même du monde actuel. Il y a une tendance, assez périlleuse de notre point de vue, à envisager ces espaces libérés comme des refuges communautaires, des marges inoffensives, bref à négliger leur « dimension antagonique », laissant du coup intactes les structures de la domination. C’est pourquoi on parle plus volontiers d’instances de « contre-pouvoir » afin d’indiquer une combinaison plus nette entre « construction » et « combat ». Alors, comment éviter cette tendance à la ghettoïsation des espaces libérés (quelle que soit l’échelle), comment préserver une articulation entre positivité préfiguratrice et fonction déstructurante ?
Jérôme Baschet : Ce que tu indiques correspond très précisément à ce que j’essaie de dire. Ce que j’appelle des « espaces libérés » ne devraient pas être considérés comme des îlots protégés, où il ferait bon vivre au milieu du désastre environnant, mais comme des espaces de combat. « Espace libéré », cela suppose qu’il faut se libérer de quelque chose, de ce qui nous opprime ou nous fait mourir à petit feu ; cela suppose qu’il y ait lutte. En réalité, ces espaces ne sont pas entièrement libérés, mais seulement en procès de l’être : ils ne sont pas débarrassés de ce qui les opprime et les assaille, ni par conséquent de la nécessité de lutter contre. En même temps qu’ils construisent dès maintenant une réalité autre, propre, échappant autant que possible aux normes du monde de l’Économie, ils ont aussi une dimension intrinsèquement antagonique.
Par conséquent, affirmer, comme le font certains, que pour sortir du capitalisme, il pourrait suffire de cesser de le reproduire, sans avoir besoin de l’affronter, c’est faire l’impasse sur la dimension antagonique de ce qu’on peut appeler aussi la stratégie intersticielle des brèches. Et j’ajouterais que les théories de l’effondrement, du moins dans la version qu’en donne la « collapsologie », me semblent induire un mouvement de fuite, parfois associée à un sentiment de panique, vers des refuges où il s’agirait d’apprendre, individuellement ou en petits groupes, à survivre à la catastrophe. En ce sens, j’ai le sentiment qu’il y a une opposition assez forte – c’est peut-être même une polarité destinée à apparaître avec une netteté croissante dans les années à venir – entre la perspective des espaces libérés, entendus dans leur dimension antagonique, et les réactions que la collapsologie encourage face à un effondrement supposément inéluctable et déjà en cours.
Bien sûr, les espaces libérés peuvent être de natures et d’échelles très différentes. Les plus modestes et les plus discrets d’entre eux, nullement méprisables pour autant, entrent sans doute moins directement en conflit avec leur environnement systémique que ceux qui atteignent une certaine dimension et qui, dans leur dynamique de création d’une réalité propre, sont conduits à rejeter plus ouvertement les normes de la société de la marchandise, voire à s’engager dans un processus de sécession vis-à-vis des institutions étatiques, comme c’est le cas de l’autonomie zapatiste. Quant aux espaces libérés associés à la lutte contre les grands projets nuisibles et inutiles, ils entrent très directement en conflit avec les forces qui soutiennent le monde de l’Économie et sont d’emblée placés sous la menace de celles-ci.
On pourrait dire que c’est généralement l’ennemi qui se charge de rappeler aux espaces libérés leur caractère antagonique, en les attaquant de diverses manières et en les contraignant à la défensive. Mais ce rappel d’un antagonisme défensif est insuffisant. Construire et multiplier des espaces libérés est certainement une manière positive de contribuer à l’émergence d’un monde débarrassé de la tyrannie capitaliste. Mais on ne saurait se cacher que ces espaces affrontent des difficultés considérables, pas seulement en raison des agressions dont ils font l’objet mais aussi du fait des spirales de division et de délitement interne qui, bien souvent, les minent de l’intérieur. Dans ces conditions, il est raisonnable de penser qu’ils ne peuvent prospérer qu’à la condition qu’une lutte plus ample soit en mesure d’attaquer la puissance de la synthèse capitaliste. C’est pourquoi le souci de la survie des espaces libérés devrait inciter, non pas à se replier sur leur seule construction, mais à associer celle-ci à un combat plus large contre le monde de l’Économie. Les espaces libérés peuvent alors être conçus comme autant de bases permettant de tendre des ponts vers d’autres luttes et d’intensifier l’offensive contre l’ennemi.
On pourrait, par exemple, développer une stratégie associant multiplication des espaces libérés et blocage généralisé. Dans la mesure où les espaces libérés permettent de déployer des ressources matérielles et des capacités techniques propres, ils devraient constituer des points d’appui précieux pour amplifier, le moment venu, des dynamiques de blocage, sous des formes multiples. Plus on dispose d’espaces libérés, plus cela devrait permettre d’étendre notre capacité de blocage. Inversement, plus les blocages s’étendent, plus ils favorisent l’émergence de nouveaux espaces libérés.
Un autre aspect consisterait à créer davantage de liens entre les espaces libérés existants. C’est un point important, sur lequel un réel besoin se fait sans doute largement sentir, mais sur lequel on a trop peu avancé. Reprenant une idée déjà lancée antérieurement, les zapatistes viennent de proposer, dans un récent communiqué du mois d’août, de reprendre des discussions en vue de la création d’un réseau planétaire de résistances et de rébellions. Il pourrait y avoir de nombreuses initiatives en ce sens, et il serait certainement précieux que les multiples géographies rebelles se rencontrent davantage, se connaissent mieux et parviennent à échanger propositions, expériences et formes concrètes de soutien mutuel. En tout cas, pour les zapatistes, il est clair que la création de l’autonomie dans leurs territoires du Chiapas, aussi importante soit-elle pour la vie concrète de dizaines de milliers de personnes, n’est pas une fin en soi ; elle n’a de sens qu’associée à une lutte globale contre ce qu’ils ont appelé l’hydre capitaliste. Et c’est pourquoi ils n’ont cessé d’organiser des rencontres internationales, voire « intergalactiques »…

7. Question complémentaire : si les espaces libérés se multiplient et qu’ils sont porteurs d’un véritable potentiel antagonique, il est évident, comme tu le dis, que « les maîtres du monde et ceux qui les servent ne renonceront pas volontiers à leurs privilèges ». Se pose donc aussi une problématique d’autodéfense, et de désarticulation du commandement ennemi. Comment l’envisager aujourd’hui, compte tenu de la militarisation du maintien de l’ordre et du développement des technologies de la répression ?
Jérôme Baschet : On y revient : les espaces libérés sont des lieux de construction collective ; mais ils doivent aussi être défendus. On peut dire que l’échelle et la radicalité des espaces libérés que l’on est en mesure de construire est directement proportionnelle à la puissance collective dont on dispose – et notamment à la capacité d’auto-défense que l’on est capable de mettre en jeu. À cet égard, il faut rappeler que la construction de l’autonomie zapatiste n’aurait certainement pas été possible sans le soulèvement armé du 1er janvier 1994. Et même si l’autonomie a un caractère civil et s’est développée en se dissociant de l’organisation politico-militaire zapatiste, elle n’a sans doute pu persister jusqu’à maintenant que parce qu’elle bénéficie de la protection des armes (les zapatistes ont renoncé à l’usage offensif des armes, mais les ont conservées à des fins défensives). Plus largement, il faut bien constater qu’aujourd’hui, les deux territoires libérés qui ont pu pousser le plus loin la construction de l’autonomie, le Chiapas zapatiste et le Rojava kurde, sont liés à des contextes où la lutte armée joue ou a joué un rôle certain.
Il ne s’agit pas de prôner la lutte armée – ce que les zapatistes ont bien pris soin de ne jamais faire depuis leur apparition publique en 1994. Mais cela permet de souligner le lien très direct entre ampleur des espaces libérés et nécessaire capacité d’auto-défense. Il y a bien sûr des formes d’auto-défense qui ne passent pas par l’usage des armes. De nombreuses luttes en font l’expérience et on l’a vu, par exemple, lors de l’opération César, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en 2012. Mais cela suppose une conjonction réussie associant capacité ample de mobilisation, engagement corporel collectif, détermination infaillible à défendre ce à quoi on tient, intelligence tactique et inventivité, sans oublier les moyens matériels, logistiques et techniques qui vont avec. Certes, plus l’ennemi élève le niveau de la répression et les moyens mis au service du « maintien de l’ordre » et de la poursuite du monde de l’Économie, plus la défense des espaces libérés devient difficile. Il n’y a guère de recette en la matière, mais il est clair qu’il n’y a pas d’autre option que de gagner en force conjointement sur tous les points que je viens de mentionner (et sans doute d’autres encore).
Je voudrais redire, pour finir, que nous sommes plongés dans une crise structurelle telle que le système capitaliste ne peut se reproduire qu’au prix de difficultés sans cesse croissantes à la fois pour nous et pour lui – et, en premier lieu, au prix d’une destruction écologique et humaine de plus en plus intolérable. Dans un tel contexte, il est prévisible que s’intensifie l’antagonisme entre, d’un côté, le monde de l’Économie, prêt à tout pour persister, alimenter l’hypertrophie quantitativiste de la valeur et préserver les privilèges de quelques-uns, et, de l’autre, les espaces libérés, associés à des formes multiples de sursaut face à l’ampleur de la dévastation. Si cette hypothèse devait paraître dotée d’un minimum de crédibilité, il serait sans doute opportun de s’y préparer.
Jérôme Baschet est historien. Longtemps enseignant-chercheur à l’EHESS à Paris, il est actuellement professeur à l’Université autonome du Chiapas, à San Cristóbal de Las Casas. Auteur de plusieurs ouvrages d’histoire médiévale, il a aussi publié Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits (La Découverte, 2018) et La Rébellion zapatiste (Champs-Flammarion, réédition augmentée 2019).